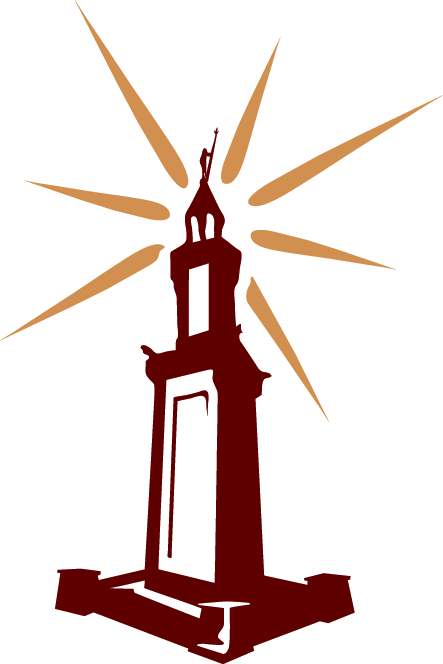On trouvera ici des remarques de la part de quelqu’un qui n’est ni helléniste, ni anthropologue, ni historien. De la part d’un lecteur persuadé depuis longtemps − j’ai connu Nicole Loraux en 1972 et je n’ai cessé de la lire depuis cette époque − que son travail ne s’adresse pas uniquement à des spécialistes du domaine grec, mais qu’il a des incidences sur d’autres disciplines, notamment sur cette espèce de non-discipline qu’est ce qu’on appelle la philosophie, quand elle sait qu’elle peut échouer et qu’un tel échec n’entame en rien son expérience, sa détermination.
Ce qui est l’occasion d’une première remarque. Le travail de Nicole Loraux me semble être, sur le terrain des études grecques, celui qui s’approche le plus de propos et de questions qui peuvent concerner directement la pratique de la philosophie — la philosophie en tant qu’elle se produit avant tout dans le ressassement de son commencement grec. Pendant des décennies, une certaine idée a prévalu ici et là en philosophie, selon laquelle − pour le dire très vite − il y avait une véritable coupure entre ceux qu’on appelle les Présocratiques et Platon. Une lecture rapide de Heidegger − ou parfois même de Nietzsche − a contribué à renforcer cette représentation et à lui accorder une certaine efficace, faisant comme si l’essentiel se trouvait forcément soit d’un côté soit de l’autre. Ce qu’on voit continuellement dans le travail de Nicole Loraux est qu’une telle rupture n’a aucun sens, qu’elle ne saurait avoir aucune portée. Rien ne permet de maintenir une hypothèse de cette nature. Il convient par conséquent d’avoir un autre regard sur d’éventuels clivages dans la pensée grecque, sur des temporalités qui pourraient y jouer un rôle d’une autre espèce et répartir tout autrement les éléments en question. La chose peut se vérifier à chaque moment dans les différents textes qui évoquent et qui analysent la stasis. En outre, il y a à l’évidence un usage de la pensée nietzschéenne chez Nicole Loraux qu’il faudrait analyser dans le détail — un usage qui ne concerne pas seulement, comme on serait tenté de le croire, le premier Nietzsche, celui de La Naissance de la tragédie.
On sait l’importance qu’avait un tel objet dans toute la démarche de Nicole — une importance qui n’a fait que croître avec les années. (Le temps qu’il faut à chacun pour dessiner les contours de son objet propre, pour l’apprivoiser en quelque manière, pour en prendre toute la mesure. Il est pour nous passionnant de voir la stasis envahissant peu à peu, de plusieurs façons, tous les domaines d’étude, relevant d’une évidence incontestable, s’imposant. Plaisir de la relecture.) Pour s’en saisir, il lui a fallu déborder son terrain supposé [1] et s’aventurer notamment sur le terrain censé être celui de la philosophie par le biais de certaines questions. Des questions qui portent avant tout sur le statut de l’oubli — un oubli qui n’est pas une absence, qui n’est pas un trait négatif, qui appelle donc des déterminations paradoxales et un traitement des textes bien particulier. Car on est en présence d’une sorte d’impossibilité logique, un adunaton qui se dit par plusieurs biais. Par exemple, dans l’ordre du discours, « l’occurrence simultanée des deux sens du mot stasis » ; ou encore le trouble qui est susceptible de naître du fait que « ce qui était le nom philosophique de la station a pris son sens politique de sédition ». Une contradiction dans les termes, dirait-on. A chaque fois, on verrait une circulation entre des dimensions en principe incompatibles.
La stasis est un objet particulièrement encombrant pour tout un chacun, comme un signifiant imprenable qui pousse le chercheur à parcourir des chemins très peu fréquentés et à multiplier les abords. Au point que, pour éclairer l’ensemble de son propos, pour tenter de délimiter son champ, Nicole Loraux fait tour à tour appel au linguiste, à l’historien et au philosophe : Pierre Chantraine, Moses Finley, Jean-Toussaint Desanti. Trois modes de saisie qui ont pour effet de pousser le chercheur à aller plus loin et, d’une certaine manière, à brouiller de fait les pistes ; qui s’accompagnent aussi, parfois, d’un recours à la psychanalyse, à certaines notions provenant en tout cas de cette discipline récente. Ici, le nom de Michel de Certeau est à l’évidence le plus représentatif, le plus significatif, lui qui n’a cessé de s’aventurer en tant qu’historien dans cette direction à propos d’objets tout autres, qui a tout fait pour préciser la nature d’emprunts de cette espèce, pour leur donner une sorte de légitimité ; lui qui a engagé une réflexion d’une grande acuité sur la dimension moderne du politique, une réflexion dans laquelle certains éléments [2] de la théorie freudienne étaient tout particulièrement sollicités — sur un mode qui retient l’attention.
Un des aspects majeurs du problème de la stasis est, à mon sens, cette diversité d’abord, ce pluriel nécessaire dans l’approche, dans le traitement. Aucune discipline n’est à elle seule capable de traiter de la stasis, de traiter la stasis en tant que telle. (On doit se déplacer d’un usage à l’autre du verbe traiter : parler de la stasis pour chercher à y remédier… ; saisir des prolongements dans les lieux les plus inattendus ; comprendre qu’à simplement l’évoquer on ne fait qu’accroître les embarras de la pensée.) Ce serait l’intraitable par excellence, ce sur quoi on vient nécessairement buter ; une sorte d’énigme majeure au seuil et au principe du monde grec. On y verra tout autant la fin de toute approche qui privilégierait l’ordre et l’harmonie ou des qualités du même ordre : le deuil à faire d’un humanisme fade qui trouvait sa légitimité dans une vision restreinte ou sommaire du monde grec. Objet particulièrement résistant, la stasis serait aussi, si l’on suit les analyses proposées par Nicole Loraux, ce qui n’est jamais entièrement décrit ou analysé, jamais saisi strictement par ceux qui sont au premier chef concernés par elle. Pour le dire schématiquement, la société grecque ne parvient pas à prendre la mesure du double sens qui la constitue ; elle vit probablement grâce à cet insu ; elle ne peut pas être contemporaine de la violence qu’elle contient (à tous les sens de ce terme). L’historien doit, ici plus qu’ailleurs, se faire anthropologue, et c’est également ce qui le conduit à rencontrer des problèmes d’une certaine généralité, quand ils ne sont pas d’ordre philosophique [3] . Sans parler même de l’emploi qui paraît s’imposer de faire résolument appel à une notion aussi difficile à manier que celle de « refoulement » [4] et d’en renforcer même parfois l’usage, quitte à devoir en étendre la portée — dans la mesure où la cité, on le sait maintenant grâce à ce travail, a effectivement une « âme ». Je ne reprends pas le détail des analyses de Nicole Loraux à ce propos, celles qu’on trouve dans La cité divisée et dans La Tragédie d’Athènes, celles qui sont dispersées et qui témoignent d’un traitement interminable.
Je voudrais seulement souligner quelques points qui me semblent tout à fait déterminants dans cette perspective — la perspective de ce gros œuvre qui est l’objet le plus singulier de la démarche de Nicole ; celui qui lui tenait le plus à cœur, je crois ; celui qui est, à mes yeux, le plus excitant et le plus riche. Un domaine sur lequel en tout cas elle s’est montrée particulièrement perspicace et inventive. D’autant plus que se préoccuper d’un tel objet − si l’on peut ainsi désigner la stasis dans ses principaux aspects − revient à bousculer les frontières des savoirs par lesquels le monde grec nous est connu, par lesquels il nous est devenu accessible. Mettre l’accent sur un terme de cette puissance et de cette portée a aussi pour conséquence de nous rendre les Grecs un peu plus étranges encore, familièrement étranges. Grandes variations sur la distance qui est censée nous séparer d’eux − ou parfois nous en rapprocher −, qui sont assez fréquentes dans le sillage des travaux de Jean-Pierre Vernant. Longs développements sur les diverses croyances qui sont comme secrétées par une telle distance ou par ce qu’on suppose être de cette nature.
Comme tout objet véritable, la stasis est sous le signe de l’interminable. À relire tous les textes à ce propos, j’ai le sentiment que l’auteur n’en a jamais fini avec un tel objet — et ce pour des raisons essentielles et des motifs différents. Ce qui est le plus manifeste, tout d’abord, c’est l’oscillation forte entre deux démarches, entre deux modalités qui ne sont pas toujours compatibles : celle qui relève de l’histoire [5] et celle qui procède de l’anthropologie. Il y a là la marque d’une souplesse, c’est-à-dire d’une capacité de se déplacer d’un domaine à l’autre, d’une discipline à l’autre, quand cela s’avère nécessaire, pour remédier aux défauts de l’une par les ressources de l’autre, voire pour ouvrir d’autres pistes de réflexion. On y verra, tout autant, un moyen d’introduire et dans le champ de l’histoire et dans celui de l’anthropologie des questions qui ne s’y trouvent pas d’ordinaire ou fort peu ; des questions qui s’imposent comme d’elles-mêmes dès qu’on décide, comme c’est explicitement dit et fait, de « ne pas prendre trop au pied de la lettre les discours que les Grecs tiennent à propos du politique » ; dès qu’on modifie l’angle de vue le plus courant − ou le plus commode − et qu’on s’intéresse en priorité « aux mots absents du discours civique » [6] . Au principe de cette manière de faire, je retrouve la même détermination : celle qui consiste à toujours travailler en considérant les discours ou les textes comme des espèces de symptômes, en tout cas comme des ensembles dont les lacunes importent autant que les parties les plus évidentes. Ce que Nicole Loraux a compris de par son travail même : que l’absence parle à un titre ou à un autre, que les lacunes signifient, à la condition qu’on sache tendre l’oreille ; à la condition qu’on se donne la liberté de faire usage de catégories philosophiques aussi bien que de notions psychanalytiques, voire de termes de provenance incertaine, c’est-à-dire d’instruments qui peuvent par ailleurs être considérés comme strictement anachroniques (le reproche n’a pas manqué, de la part des plus frileux…)
Le risque de l’anachronisme fait manifestement partie de cette détermination : un risque pris donc en toute connaissance de cause ; une forme d’affirmation nécessaire dans toute recherche, et d’autant plus sans doute quand l’objet est tout à la fois lointain et proche — réputé [7] tel en tout cas. Il n’y a aucun éclectisme dans cette manière de procéder ; mais plutôt le souci de multiplier les abords, de chercher son bien là où il peut se trouver, de faire preuve d’un certain empirisme dans l’ordre de la « méthode ». Autre manière de dire qu’il ne saurait y avoir de méthode préalable dans une telle perspective, rien qui puisse ressembler à de voies déjà frayées ou à des garanties quant aux façons de procéder. Il faut dire qu’il y a eu là une véritable aventure de pensée : solitaire donc, même si elle a su produire d’autres recherches dans son sillage. Aventure qu’un de nos grands aînés appelait superbement le bricolage.
Je proposerai en bref ceci : un empirisme constamment audacieux. Un empirisme qui s’accompagne, comme il se doit, de fragments de récit (direct ou indirect, en première ou en troisième personne). On dira même : des fragments de Bildung intellectuelle et politique qui participent de plein droit à la démarche, à cette construction patiente et particulièrement minutieuse que semble appeler la stasis. Avec un autre trait qui va dans le sens de cet empirisme singulier : le chercheur parle obligatoirement plusieurs langues ici, est à l’écoute de dialectes différents et de bruissements indéterminés ; les textes, quand bien même ils sont tardifs, ne présentent aucune homogénéité, ne relèvent d’aucune linéarité [8] . Il est frappant de voir qu’à plusieurs reprises, dès qu’il est question à un titre ou à un autre de la stasis, Nicole Loraux raconte partiellement, comme par petites touches, l’histoire de sa formation. Une histoire qui évoque les conflits, les différends, les options, les partis pris, les réseaux, le contexte [9] ; toutes ces choses dans lesquelles sont entremêlés de l’intellectuel et du politique ; tous ces événements à partir desquels un travail aussi conséquent prend son véritable sens, à partir desquels il montre sa richesse véritable. « Notre jeunesse », disait Péguy pour évoquer des propos de même nature, pour parler d’aventures de pensée qui ne sont pas foncièrement différentes de celles de notre génération. Soit, comment, dans le sillage des travaux de Jean-Pierre Vernant et de Pierre Vidal-Naquet, se sont transformées les études grecques — une transformation fondamentale qui n’allait pas de soi et qui s’accompagnait de polémiques souvent très vives. Soit, encore, les quelques pas qui ont été nécessaires en marge de l’institution, des pas grâce auxquels ce travail a montré toute sa fécondité. On dira autrement : qu’on ne saurait parler sans raisons de la stasis. Des raisons d’histoire, si l’on peut dire, d’histoire intellectuelle collective autant que personnelle : ce sont comme des moments où les deux histoires se mêlent selon une logique qu’on n’évalue le plus souvent que par la suite, que dans un certain après-coup ; des moments contrastés dont le travail a su tirer le plus grand parti et qui participent de plein droit à l’ensemble de la démarche.
On n’est sans doute pas très loin du Lévi-Strauss de Tristes tropiques ou, pour prendre une référence explicitement donnée par Nicole Loraux, et commentée avec beaucoup de vigueur par elle, de Jules Isaac et de son grand livre Les Oligarques. Les parentés s’affichent, s’affirment même, à mesure que les contours de l’objet deviennent plus évidents, à mesure que les embarras se précisent [10] . Et, dans le même mouvement, la dette – pour prendre ce terme trop commode – se fragmente, perd son unité factice, commence à s’analyser elle-même : des équilibres antérieurs se modifient ; des croyances initiales sont bousculées ; l’ordinaire du travail de recherche en somme, mais rarement montré en tant que tel. J’ai la conviction que Nicole a su parler, avec une grande justesse et assez souvent, des effets de cette virulence très particulière qui est au cœur de toute véritable recherche, et que ce n’est en aucun cas un aspect mineur de sa démarche. Ne faut-il pas dire, à titre d’hypothèse au moins, que la stasis est en quelque manière constitutive du sujet qui se risque sur de tels terrains? Qu’elle permet d’indiquer en tout cas une certaine division grâce à laquelle ce sujet commence à travailler, c’est-à-dire à se mettre à l’écoute des différents dissentiments de l’ « âme » ? Ne peut-on pas supposer qu’avec la description et l’analyse de la stasis dans la cité on a, en même temps, les prémisses d’une analytique de l’âme en général ?
Le choix d’objet intellectuel n’est jamais insignifiant pour un sujet, jamais le simple fruit de stricts hasards. Rien n’interdit par conséquent − si ce n’est les habitudes, les convenances académiques ou les refoulements individuels… − d’évoquer ce qui établit des liens dans cette perspective, la manière dont avec le temps tout cela fait sens — quand bien même cela s’accomplit dans la discordance. Rien n’interdit au sujet de mentionner − par les biais qui lui conviennent ou qu’il est à même d’inventer pour la circonstance − les rapports qu’il établit peu à peu avec ses objets de travail, avec ses objets de dilection, la façon dont il se les approprie, ce qu’il est à même d’en faire ; ce qu’il en retient ; comment il se modifie lui-même dans de tels contacts et les « raisons » de telles modifications. Rien n’empêche même d’évoquer les temporalités paradoxales qui se font jour tout particulièrement dans le travail intellectuel : tel objet daté, très lointain dans le temps, semblant obsolète ou de peu d’intérêt, fait signe, consonne singulièrement au présent — à la condition qu’on sache reconnaître ce dans quoi on naît, ce par quoi on ne cesse de se former, à la condition également qu’on sache cerner ces formes singulières de présent continué. Quelques noms à ce propos que j’associe désormais au travail de Nicole : Michelet, Nietzsche, Péguy, Walter Benjamin. Il y a évidemment aussi, dans ce style d’abord, dans cette dispersion apparente, une façon significative d’énoncer, autant qu’il est possible, les enjeux d’une formation, les effets d’une Bildung, une manière de les formuler pour enraciner plus nettement la démarche — comme pour lui donner davantage de chances. C’est, je crois, ce que Nicole n’a cessé de faire : en quoi elle date de la manière la plus conséquente son travail de recherche et, en même temps, elle l’ouvre à un avenir possible, elle fait en sorte qu’il y ait une éventualité supplémentaire d’être entendu.
L’empirisme m’apparaît comme la manière la plus nette de caractériser sa démarche. J’entends par là : l’exposé patient des façons de faire et des manières d’approcher l’objet, en même temps que des brefs récits de formation ; sur le fond d’une démarche qui trouve ici et là ses instruments : dans l’histoire, dans l’anthropologie, dans la linguistique, dans la théorie freudienne, dans la littérature également. En somme, il s’agit de puiser dans des disciplines qui ont manifestement des âges différents. (L’anachronisme est aussi là.) La seule unité possible étant la détermination qu’un sujet met dans les entreprises qu’il forme, dans le ressassement dont il gratifie son objet, dans l’obstination à reprendre les mêmes questions et à ne jamais se satisfaire de ce qu’il propose pour y répondre. Je dirais dans cette perspective : la stasis est cette chose lointaine − et proche d’une certaine façon − avec laquelle on ne saurait en avoir fini et qui force l’historien (l’anthropologue, le linguiste, le philosophe : bref tout lecteur attentif, tout usager des choses grecques) à s’analyser. Littéralement et en tous sens. Grâce aux objets que je me donne, par la façon de les cerner, par les détours auxquels je me soumets, je m’analyse pour partie [11] . Comme dans toute analyse, il y a là des effets imprévus, de grands détours, des retards salutaires, des retours d’après-coup : c’est ce qui fait que le travail est tout particulièrement voué à se répéter, à se reprendre, à se relancer à la moindre occasion. La chose en question peut se prendre par les biais les plus divers. L’autre effet d’un tel geste est de rendre strictement impossible, impensable même, une quelconque méthodologie. Ce qu’on est susceptible de transmettre sur ce terrain est évidemment d’un tout autre ordre. Il faudra un jour s’interroger avec précision sur ce qu’on pourrait appeler la « pédagogie » − quel autre terme pourrait-on employer qui ait une telle extension ? − qui est à l’œuvre dans tous les livres de Nicole Loraux. Un jour, aussi, évoquer la très grande générosité dont tous ses livres ne cessent de faire montre.
Je rappelle, sans pouvoir m’y attarder, que c’est fréquemment sur quelques mots que la réflexion s’engage, que l’analyse se met en mouvement. Micrologie [12] qui brasse des problèmes d’une certaine ampleur, puisqu’il s’agit ici de la définition de la démocratie et de la politique, puisqu’il est toujours question d’un oubli fondateur du politique. Je repense, en disant cela, à telle remarque en apparence latérale, mais tout à fait cruciale pour l’ouverture d’éventuels chantiers. Si on examine les opérations de pensée que la réflexion des historiens grecs met en œuvre dans le récit des staseis, il nous faudra passer par l’évocation du dossier très nourri de la substitution récurrente du réfléchi au réciproque [13] .
La grammaire grecque est toujours susceptible de nous sidérer dans ses détails mêmes : faite donc de singularités à préserver, à respecter ; pour ne pas déposséder les objets nommés dans son horizon de ce qu’ils peuvent avoir de plus spécifique ou de plus énigmatique, de ce qui par là vient faire question pour tout un chacun qui lit, pour quiconque regarde avec toute l’attention requise l’original même dans ses méandres.
Pour parler de la stasis, il faudrait inventer une langue qui ne soit pas romaine. Je veux dire : qui puisse éviter le passage obligé par la notion de ”guerre civile” à laquelle, faute d’un terme plus approprié, j’ai eu et j’aurai recours. […] Avec bellum civile, c’est la ”vaste mutualité” de la cité romaine qui se pense dans l’élément de la guerre. Tout autre est stasis : mouvement immobilisé, front qui ne s’enfonce pas et installe dans la cité la paradoxale unité qui caractérise l’insurrection simultanée des deux moitiés d’un tout. A quoi fait suite une remarque grammaticale qui a un poids considérable. Si l’on ajoute que les substantifs en -sis, ces noms verbaux expriment l’action sans la référer à aucun agent, stasis devient, à la limite, un processus autarcique, quelque chose comme un principe [14] .
La remarque est de première importance. Car elle dit d’abord que la stasis s’impose au sujet, qu’elle parle plusieurs langues ; même si l’on risque par là de perdre ce qu’elle a de plus spécifique, de plus « grec » dirait-on en simplifiant. Et l’on peut saisir sur un tel exemple les principaux enjeux de la traduction, dimension évidemment cruciale de notre rapport aux Grecs. Stasis fait partie de ces mots qui ne se traduisent pas : elle demande donc à être analysée au plus près de sa langue, appelle des détours en nombre, suscite plus que d’autres l’interprétation, déroute au plus haut point le chercheur qui la repère. On pressent par là que, dans la plupart de ses usages, le terme ne dit pas tout de lui-même, qu’il faut toujours lui adjoindre un commentaire, qu’il convient à son propos de mobiliser les ressources de la philologie autant que celles de la philosophie, sans parler des savoirs annexes dans lesquels il faut aller puiser. Mais qu’est-ce qui ne se traduit pas ? Qu’est-ce qui demeure en reste quand on dit, en latin, bellum civile ? Est-ce qu’on ne redouble pas l’oubli (et tous ses avatars) quand on passe du grec aux langues romanes ? De quoi ces glissements dans la langue − entre les langues − peuvent-ils témoigner? Comment transmettre aux modernes que nous croyons être ce qui semble être spécifiquement grec ? Et pourquoi une « pratique contrôlée de l’anachronisme » s’impose-t-elle dans une telle perspective ? On pourrait multiplier les questions à ce propos, les étendre aussi. Elles reviennent à souligner l’importance des manières de dire dans un état de la langue, les insuffisances d’une traduction et les risques qu’elle comporte. (Des questions qui sont tout aussi décisives sur le terrain de la tragédie grecque : on sait le soin mis par Nicole dès qu’elle s’occupe d’un texte tragique. Leçons pour les traducteurs bien entendu, par delà le domaine des études grecques). Mais ces questions indiquent également autre chose : l’obstacle que représente la romanité, c’est-à-dire la langue romaine et ses grandes catégories ; un obstacle qui de loin en loin affecte notre mode de pensée, celui-là même que nous désignons comme moderne. Que cela porte sur l’oubli fondateur de la politique ne saurait rester sans conséquences sur ce qui a lieu, aujourd’hui encore.
Je poursuis mon hypothèse. Tout se passe comme si, par un tel biais, Nicole Loraux reprenait à son compte (et par ses propres moyens) une des grandes intuitions de Nietzsche : ce qui nous éloigne des Grecs, ce qui nous les rend étrangers, c’est avant tout la langue latine, elle qui est le plus grand obstacle à une véritable compréhension du monde grec. On le sait, il y a de nombreux aperçus de Nietzsche à ce propos, comme une sorte de leitmotiv dans ce qui pour lui prend notamment la forme d’un « retour aux Grecs ». Une autre intuition de Nietzsche qui complète celle-ci est en bref la suivante : l’histoire ne nous est d’aucun secours pour saisir, en deçà du monde latin, ce qui peut être propre aux Grecs ; il convient d’œuvrer en direction d’une généalogie, de la forger de toutes pièces. Il faut donc une démarche d’une tout autre nature : une construction, pour reprendre un terme décisif de Freud que Nicole commente à plusieurs reprises et dont elle montre la grande pertinence pour le travail qu’elle effectue pour tenter de circonscrire la stasis. Proposer une construction de cette nature, c’est aussi se donner la possibilité de mettre au jour les mots absents du discours de la Cité. C’est devoir briser ce qui a l’apparence de l’unité, analyser ce qui s’apparente à la figure de l’Un. Nécessité donc d’une construction − et non d’une reconstruction − la nuance est déterminante. Dire construction revient, en effet, à insister sur ceci : qu’on prend la mesure de ce que signifie travailler sur des mots absents et qu’on pressent qu’une telle absence relève plus d’un évitement que d’un défaut ; que l’on s’aventure sur un terrain où le travail de l’historien se confronte à d’étranges mouvements de négation, d’effacement, de mise de côté ; que l’oubli apparaît comme l’une des conditions − sinon la condition par excellence − de l’instauration de la cité grecque ; qu’on s’engage à l’évidence dans un « univers inquiétant » où l’on doit s’appuyer sur des termes hétérogènes (linguistiques, psychanalytiques, etc.) avec lesquels on a conscience de bricoler ; qu’on est conduit à s’intéresser aux « sens opposés » d’un mot — pour reprendre une expression de Freud sur laquelle Nicole a proposé son propre commentaire. En somme, plusieurs opérations à produire en même temps, des opérations inégales et provenant d’horizons fort différents.
La « construction » est ainsi le risque assumé de faire coexister plusieurs abords, de faire coopérer partiellement plusieurs disciplines ou, plus encore, des termes relevant de plusieurs champs. La « construction » devient par là même le lieu d’un étonnement qui porte avant tout sur le « ne…pas », sur la négation dans ses diverses ressources, sur l’effacement prescrit ; sur les « rites de parole » et sur la commémoration négative ; sur l’usage généralisé (dans le champ politique) des mots à tout faire ; sur le renversement des valeurs dont la stasis devient le principe ; sur l’inflation rhétorique dans ces domaines ; sur l’étrange proximité du dire et du faire ; et ainsi de suite.
On peut rappeler qu’en 1905 Péguy écrit un texte qu’il intitule Les Suppliants parallèles, où il met en regard la pétition que les ouvriers de Saint-Pétersbourg envoient au Tsar et le début d’Oedipe Roi de Sophocle, qu’il cite en grec, qu’il retraduit et dont il commente la trame et le détail avec la plus grande minutie. Nous sommes là encore dans la construction — une construction qui, à tous les sens du mot, s’expose, qui se montre et d’un même mouvement se risque, qui énonce ce qu’elle fait et qui s’aventure. Belle forme d’anachronisme ici encore : ce qui s’écrit des Grecs a lieu en l’occurrence dans un moment qui n’est évidemment pas sans rapport avec ce qui est analysé — la stasis en d’autres termes. Deux scènes, deux lieux différents, deux époques éloignées. Mais des ressemblances, des analogies, des similitudes qui frappent quiconque a l’oreille philologique, quiconque scrute le détail des temps : autant de choses qui aident à décrire, voire à analyser, aussi bien ce lointain passé que ce présent vivant. On pourrait parler, je crois, d’un processus de double analyse, d’une construction qui dit de quoi elle est faite, de quels éléments elle est constituée ; qui permet d’évoquer également, avec la plus grande précision, la trajectoire des mots : ce dont ils deviennent capables dans un contexte déterminé, ce qu’ils produisent dans l’ordre des valeurs, de quelle manière ils nous parlent.
Ce qui en témoigne, dans le travail de Nicole Loraux, c’est l’insistance sur les « actes de langage » là où il est question de la stasis et de ce qui l’accompagne. On indiquera également, dans la même direction et pour le même propos, l’importance qu’acquiert « la polyphonie des voix » à laquelle il faut apprendre à prêter l’oreille. Il n’y a rien là qui ressemblerait à une « méthode » ou à quoi que ce soit de ce genre. Mais, tout autrement, on parlera de la patience d’une écoute des textes mêmes dans leur plus grande diversité. Une patience qui est le prélude à une généalogie — au sens fort que Nietzsche donnait à ce mot, c’est-à-dire une démarche dans laquelle, pour reprendre deux expressions de Nicole Loraux, est reconnue « l’urgente nécessité de faire dans l’histoire la part de l’affect » et d’être continuellement attentif à des « mots qui se retournent sur eux-mêmes ». En somme, une sorte de chapitre supplémentaire à l’article de Freud sur l’Unheimliche et à celui sur les « sens opposés » ; bien loin de la « psychologie historique » qui a été, comme on le sait, le point de départ des recherches de ce genre. En d’autres termes : l’affirmation même d’une démarche singulière qui prenait le temps de s’exposer.
Bibliographie
Loraux, N. 1997a. La Cité divisée. L’oubli dans la mémoire d’Athènes, Paris.
Loraux, N. 2005. La Tragédie d’Athènes. La Politique entre l’ombre et l’utopie, Paris.
Footnotes
[ back ] 1. Le terrain institué des études grecques, partagé entre des disciplines différentes.
[ back ] 2. Des manières de faire, des mots ou des concepts provenant de cet horizon.
[ back ] 3. Sur un tout autre mode, comme chez Michelet ou Edgar Quinet.
[ back ] 4. Dans l’acception freudienne.
[ back ] 5. Quelles qu’en soient les formes.
[ back ] 6. C’est Michel de Certeau qui parlait de l’absent de l’histoire, qui est fréquemment revenu sur les figures d’une telle absence.
[ back ] 7. C’est aussi cette réputation qui fait fortement obstacle au travail, qui oblige le chercheur à ruser, qui le contraint à dissoudre les mythes modernes les plus tenaces qui concernent la Grèce même. Mythes ou représentations dont l’usage politique est fréquemment plus que douteux.
[ back ] 8. Peut-être est l’une des « raisons » pour lesquelles l’anachronisme est de mise.
[ back ] 9. Comme on dit, platement.
[ back ] 10. On pourrait ajouter : à mesure que l’objet se dérobe, que ses contradictions se montrent.
[ back ] 11. Immense chapitre qui reste tout entier à écrire sur le rapport de soi à soi mis en acte, partiellement dévoilé ou approché, par une démarche de pensée. « Le travail en philosophie − comme, à beaucoup d’égards, le travail en architecture − est avant tout un travail sur soi-même. C’est travailler à une conception propre. À la façon dont on voit les choses (et à ce que l’on attend d’elles). » (Wittgenstein). Travailler sur la stasis, c’est se mettre dans la position d’en attendre (ou d’en anticiper) des effets en retour.
[ back ] 12. On peut penser à certains propos de Wittgenstein, par exemple celui-ci : « Un nuage de philosophie dans une goutte de grammaire. »
[ back ] 13. Loraux 2005 : 40.
[ back ] 14. Loraux 1997a : 105.