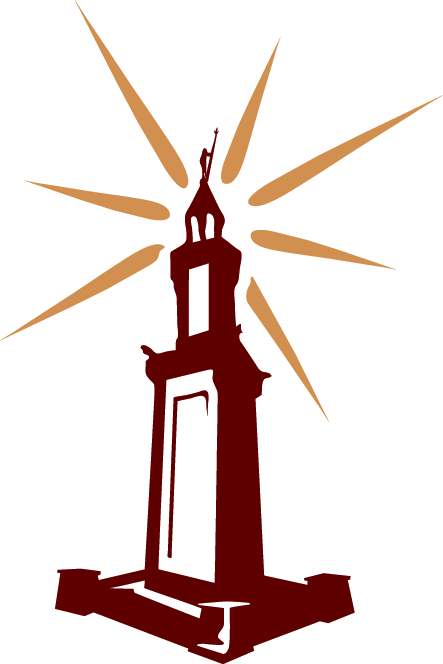Je n’envisage pas cette communication comme une oraison funèbre, quoique deuil il y ait inévitablement chez les amis, les collègues et les compagnons de route qui ont organisé cet impressionnant colloque autour de Nicole Loraux, et qui ont eu l’amabilité de solliciter la participation d’une spécialiste gréco-américaine du XVIIe siècle français. Je n’ai rencontré Nicole Loraux que dans ses textes, mais ce fut une rencontre marquante. La lecture de Façons tragiques de tuer une femme en l985 m’a éblouie par la combinaison d’érudition pluridisciplinaire, d’attention suivie « au mot à mot des textes » (Loraux 1985 : 100), et surtout, par la focalisation sur la division des sexes et le caractère fondamentalement sexué de la tragédie, du mythe, et du récit à un moment où cette approche nettement genrée n’avait guère d’existence, voire même d’écho, en France. Non, je veux plutôt envisager cette communication comme un « retour » – comme elle-même le décrivait par rapport aux Grecs – « un retour à Loraux » qui susciterait une autre lecture de Racine, le tragédien français dit « classique », l’emblème de la “littérature éternelle” au dire ironique de Roland Barthes (Barthes 1965 : 145). Ce dialogue à trois entre Loraux, Racine, et moi serait « anachronique », dans le sens méthodologique qu’elle a donné à ce concept dans son essai célèbre, Éloge de l’anachronisme en histoire (Loraux 1993). « Anachronique » évidemment dans mon rapport de lectrice à Racine, que je ne peux lire qu’à travers les préoccupations du présent, médiatisées, contrôlées, et limitées par les données du texte. Et « anachronique » tout aussi bien dans mon rapport de lectrice à Loraux − un va-et-vient entre ses concepts, ses focalisations et ses conclusions et ceux que j’inscris dans cet autre moment contextuel − historique, politique, idéologique, et (multi) disciplinaire – que forcément je représente, que j’incorpore. Comme tout savoir, toute connaissance, une lecture − la mienne ou celle de Nicole Loraux − est « située » [1] , engendrée par et à travers les différents discours qui nous constituent en tant que sujets lisants et qu’en même temps nous dépassons par notre propre agentivité (agency) [2] . J’aime à croire que cette érudite engagée, que je n’ai jamais rencontrée, soutiendrait avec l’élan qui marque son “je” textuel ce genre de dialogue « remémoratif » dans ses différends et différences − je vous rappelle qu’elle s’était penchée longuement sur la question de la façon dont on se rappelle l’autre et pour quelles raisons (Loraux 1981a) − lecture donc qui doit constituer un dialogue sur/pour notre à-venir, en particulier sur la question des femmes et du politique, de leur “rapport au pouvoir” (Loraux 2005 : 33).
*
Dans l’œuvre de Nicole Loraux, la figure d’Iphigénie revient à plusieurs reprises, à commencer par Façons tragiques de tuer une femme où elle interprète cette mort paradigmatique, non pas comme un sacrifice, mais comme un meurtre, un fantasme sur « le sang des vierges » interdit du réel, mais dont la pensée dangereuse ou insupportable peut se manifester sur scène, à l’heure cruciale où le combat s’engage pour le salut de la communauté des andres (Loraux 1985 : 62-65). Et Loraux de souligner le lien étroit entre le sacrifice et le mariage, le cortège funèbre et le lit nuptial où le rôle de sacrificateur revient souvent au père (68). Dans Les Mères en deuil (1990), où elle évoque une Iphigénie « à peine détachée du corps » de Clytemnestre (63), Loraux insiste sur l’idée que « le deuil gémissant est féminin » (22), qu’il existe une essence féminine qui est réprimée en l’homme (40). Le meurtre de la fille mènera donc à la vengeance meurtrière de la mère, phénomène qui, pour Loraux, est nettement genré dans la tragédie athénienne : si l’enfant sacrifié est un fils, la mère tuera des fils, en tant que représentants du père, mais si l’enfant est une fille, la mère finira par tuer le père (83).
Cette conclusion est tirée empiriquement et historiquement du corpus tragique que Loraux a lu et relu avec une intensité profondément productrice. Par contre, sa pensée quant à la nature du deuil me semble problématique en raison de son parti pris essentialiste, sa présomption d’une existence transhistorique du « féminin », même dans les moments lorauxiens où cet opérateur du « féminin » est postulé comme concept heuristique. Pour une lectrice féministe transatlantique qui a traversé « les guerres de l’essentialisme » aux États-Unis [3] , la différence – la disjonction – entre « les femmes » et « le féminin » − mise en relief dans le titre de cette session de notre colloque [4] − est capitale : elle a des présupposés et des conséquences méthodologiques, idéologiques et politiques ; je reviendrai à cette problématique à la fin de ma communication sur L’Iphigénie en Aulide de Racine.
**
Le plus grand succès de la carrière de Racine, cette version du mythe d’Iphigénie que le futur historiographe de Louis XIV créa pour la grande fête de l674 à Versailles [5] , traite effectivement du « salut de la communauté des andres » (Loraux 1985 : 62-65), et met même en scène l’étiologie de sa fondation : maîtriser la sexualité des femmes. À première vue, cette lecture « moderne » contredit la préface de ce partisan des « anciens », qui affirme l’identité entre l’ancien et le moderne, et donc la transhistoricité de la tragédie : « …Mes spectateurs ont été émus des mêmes choses qui ont mis autrefois en larmes le plus savant peuple de la Grèce…le bon sens et la raison [sont] les mêmes dans tous les siècles » (Clarac 1962 : 225). Mais cette déclaration est contredite par de longues justifications sur les changements qu’il dut faire pour que le texte d’Euripide plaise [6] à ses spectateurs, surtout le dénouement où Diane s’apitoie sur le sort d’Iphigénie au moment du sacrifice et substitue « une autre victime », pendant que la fille du roi est enlevée et portée dans la Tauride (224) [7] . Racine (Clarac 1962 : 225) explique :
Quelle apparence que j’eusse souillé la scène par le meurtre horrible d’une personne aussi vertueuse et aussi aimable qu’il fallait représenter Iphigénie ? Et quelle apparence encore de dénouer ma tragédie par le secours d’une déesse et d’une machine, et par une métamorphose, qui pouvait bien trouver quelque créance du temps d’Euripide, mais qui serait trop absurde et trop incroyable parmi nous.
Au delà des exigences de vraisemblance et des notions de la justice propres au XVIIe siècle, le fait qu’il « fallait représenter » Iphigénie « vertueuse » et « aimable » dévoile les contraintes qui pesaient sur Racine; en particulier, comment représenter la fille aimée du roi devant Louis XIV, qui s’était apparemment prononcé contre son « meurtre ».
La victime sera donc un personnage inventé par Racine sous le nom d’Ériphile, « une autre Iphigénie », qui est révélée par le prêtre/prophète Calchas comme la fille illégitime d’Hélène et de Thésée : « Je n’aurais jamais osé entreprendre cette tragédie », avoue Racine, « sans la trouvaille heureuse de ce personnage » (225). Tout comme les Grecs doivent sacrifier une vierge pour pouvoir partir vers Troie, Racine doit trouver une femme sacrifiable pour dénouer l’impasse de sa tragédie et plaire, c’est-à-dire captiver le roi et les spectateurs. Le fait qu’ Ériphile est le seul personnage que Racine dit avoir « pu représenter tel qu’il m’a plu » (225) peut donc nous aider à préciser les données de la femme sacrifiable, celle qui peut être supprimée selon l’idéologie du XVIIe siècle, notion qui est promue à l’état de vérité transhistorique, voire universelle, par la mise en scène de mythes, de personnages, et de textes classiques. À ma re-lecture, Ériphile est « sacrifiable » parce que c’est une étrangère impuissante, une esclave de guerre qui ne sait même pas l’identité de ses parents. Mais dans la logique affichée du texte, elle est sacrifiable – en fait monstrueuse – par sa passion interdite pour Achille et parce qu’elle incarne et sème le désordre dans le couple, la famille, et l’État. Ce faisant, Racine met sur scène une division binaire entre femmes − la bonne et la mauvaise, l’idéale et la monstrueuse − division qui sert à justifier les structures disciplinaires du système politique et idéologique.
***
La mer immobile et les « vents déchaînés » qui ont fermé le chemin vers Troie aux mille vaisseaux grecs et vingt rois depuis trois mois avant le début d’Iphigénie en Aulide reproduisent le renfermement typique des pièces de Racine (Acte I, scène 1, v. 27-3l), ici une atmosphère explosive qui « Trouble toute la Grèce et consume l’armée » (Acte I, scène 1, v. 186). Le prêtre Calchas a prédit à Agamemnon, roi du nouvel État féodal de Grèce, que cette armée n’atteindra jamais Troie
Si dans un sacrifice auguste et solennel
Une fille du sang d’Hélène
De Diane en ces lieux n’ensanglante l’autel.
Pour obtenir les vents que le ciel vous dénie,
Sacrifiez Iphigénie.
Une fille du sang d’Hélène
De Diane en ces lieux n’ensanglante l’autel.
Pour obtenir les vents que le ciel vous dénie,
Sacrifiez Iphigénie.
(Acte I, scène 1, v. 58-62) [8]
Cet « ordre barbare » qui suscita « la compassion et la terreur de la cour », selon la préface de Racine (Clarac 1962 : 225), met Agamemnon en proie aux conflits entre État et famille, devoir et amour (Acte I, scène 5, v. 365-366, 368), à un tel point qu’il change d’avis sur le sacrifice de sa fille sept fois au cours de la pièce. En fait ces revirements proviennent beaucoup moins d’un amour pour Iphigénie que de la faiblesse, la peur, une rivalité homosociale, et une obsession du pouvoir. Agamemnon craint l’autorité de Calchas sur « le peuple furieux » qui pourrait menacer sa vie s’il lui refusait une victime (Acte I, scène 2, v. 293-295), et il craint les hommes qui « Réveilleront leur brigue et leur prétention / M’arracheront peut-être un pouvoir qui les blesse » (Acte I, scène 1, v. l40), le pouvoir qu’il désire au delà de tout :
Charmé de mon pouvoir, et plein de ma grandeur,
Ces noms de roi des rois et de chef de la Grèce
Chatouill[ent] de mon cœur l’orgueilleuse faiblesse.
Ces noms de roi des rois et de chef de la Grèce
Chatouill[ent] de mon cœur l’orgueilleuse faiblesse.
(Acte I, scène 1, v. 79-82)
Au cours de la violente confrontation de l’Acte IV, Clytemnestre dénonce l’idolâtrie du pouvoir de son mari :
Cette soif de régner, que rien ne peut éteindre,
L’orgueil de voir vingt rois vous servir et vous craindre,
Tous les droits de l’empire en vos mains confiés,
Cruel, c’est à ces Dieux que vous sacrifiez.
L’orgueil de voir vingt rois vous servir et vous craindre,
Tous les droits de l’empire en vos mains confiés,
Cruel, c’est à ces Dieux que vous sacrifiez.
(Acte IV, scène 4, v. l290-l292)
Clytemnestre est hantée par le fantasme du corps mutilé, disséqué, de sa fille :
Un prêtre, environné d’une foule cruelle,
Portera sur ma fille une main criminelle ?
Déchirera son sein ? Et d’un œil curieux
Dans son cœur palpitant consultera les Dieux ?
Portera sur ma fille une main criminelle ?
Déchirera son sein ? Et d’un œil curieux
Dans son cœur palpitant consultera les Dieux ?
(Acte IV, scène 4, v. 1301-1304)
Prête à mourir au lieu de sa fille ou de mourir avec elle dans un double sacrifice qui maintiendrait leur union − « La mort seule, la mort pourra rompre les nœuds / Dont mes bras nous vont joindre et lier toutes deux » (Acte V, scène 3, v. 1635-1636) − Clytemnestre sera violemment empêchée de partir vers l’autel sacrificiel avec sa fille. Qu’Iphigénie essaie de faire jurer sa mère − que « si vous m’aimez, par cet amour de mère/Ne reprochez jamais mon trépas à mon père » (Acte V, scène 3, v. 1653-1654) − est une des ironies de la tragédie de Racine, qui oriente le spectateur vers des mythes meurtriers au delà de son propre dénouement [9] .
Comparée à Clytemnestre, Iphigénie ne cesse d’exprimer son amour et son orgueil pour son père devenu roi :
Quels honneurs ! Quel pouvoir ! Déjà la Renommée
Par d’étonnants récits m’en avait informée ;
Quel bonheur de me voir la fille d’un tel père !
Par d’étonnants récits m’en avait informée ;
Quel bonheur de me voir la fille d’un tel père !
(Acte II, scène 2, v. 541-542, 545-546)
Ce soi-disant bonheur est une des autres ironies de cette pièce, qui exploite l’ambiguïté, que Nicole Loraux a relevée, entre l’autel nuptial et l’autel sacrificiel (1985). Ce qui est même plus ironique, la mort d’Iphigénie, la condition sine qua non du pouvoir d’Agamemnon, supprimera la seule personne qui le considère absolu. En fait, quand son sacrifice imminent lui est révélé − et par la même lui est révélée la perfidie de son père − Iphigénie, loin de manifester une trace de colère, prononce le credo qu’Agamemnon est « un père que j’aime, un père que j’adore » (Acte III, scène 6, v. l002-1003, l0l9). Tout comme Dieu ou un roi de droit divin, Iphigénie considère sa propre vie comme la propriété de son père :
Quand vous me commanderez, vous serez obéi.
Ma vie est votre bien; vous voulez le reprendre :…
D’un oeil aussi content, d’un coeur aussi soumis
Que j’acceptais l’époux que vous m’aviez promis,
Je saurai, s’il le faut, victime obéissante,
Tendre au fer de Calchas une tête innocente ;
Et respectant le coup par vous-même ordonné
Vous rendre tout le sang que vous m’avez donné
Ma vie est votre bien; vous voulez le reprendre :…
D’un oeil aussi content, d’un coeur aussi soumis
Que j’acceptais l’époux que vous m’aviez promis,
Je saurai, s’il le faut, victime obéissante,
Tendre au fer de Calchas une tête innocente ;
Et respectant le coup par vous-même ordonné
Vous rendre tout le sang que vous m’avez donné
(Acte IV, scène 4, v. 1176-1184)
On a prétendu que la fille d’Agamemnon incarne la constance stoïque, la générosité et la compassion dans un monde barbare ou de petits bourgeois, ou même la charité de la pucelle chrétienne. Mais Lucien Goldmann a raison de conclure qu’Iphigénie ne se révolte jamais contre le pouvoir et donc ne peut être tragique (Goldmann 1955 : 410); et Barthes de constater que ce n’est pas un sujet qui atteint la vertu, mais un « personnage objet » (Barthes 1965 : 105). À mon sens, celle qui mit en larmes la cour de Louis XIV, comme Racine nous le dit dans sa préface (Clarac 1962 : 225), serait la fille patriarcale par excellence, et par métonymie, le sujet idéal de l’État absolutiste [10] .
Une telle lecture n’exigerait pas la mise en scène d’un roi exemplaire — à vrai dire, l’Agamemnon de Racine est, à plusieurs sens, l’antithèse de l’image sur-héroïque soigneusement fabriquée et disséminée de Louis XIV. Mais par les procédés oniriques de l’inconscient politique du texte [11] , la faiblesse d’Agamemnon et la fragilité du jeune État féodal grec pourraient évoquer le fantasme du désordre de la Fronde qui avait traumatisé l’enfance de Louis XIV, et en même temps, par condensation, mettre en relief la nécessité − et fournirait l’alibi − pour une monarchie absolutiste incarnée par le Roi Soleil. En fait, croire que le roi est le détenteur de la vie, et adorer celui qui en causerait la mort pourrait composer le fantasme ultime d’une politique impériale au moment où Louis XIV se livrait à des guerres d’expansion sur le continent, et exploitait un commerce colonial et esclavagiste dans le nouveau monde.
Achille s’efforce de remplacer le père comme objet principal de l’amour d’Iphigénie. Il proclame ses droits sur ceux du père, qui s’en défend :
Agamemnon : Et qui vous a chargé du soin de ma famille ?
Ne pourrai-je sans vous disposer de ma fille ?…
Achille : Non elle n’est plus à vous…
Je défendrai mes droits fondés sur vos serments
Ne pourrai-je sans vous disposer de ma fille ?…
Achille : Non elle n’est plus à vous…
Je défendrai mes droits fondés sur vos serments
(Acte IV, scène 6, v. 1346-1352, 1356)
Ce débat juridique sur Iphigénie, objet d’échange entre hommes, cache une rivalité homosociale profonde entre les deux chefs. Elle provient de la blessure narcissique qu’Achille ressent face à la préférence qu’Iphigénie manifeste de vivre selon les « ordres absolus du père » (Acte V, scène 2, v. 1573, 1583, 1586). De son côté, Agamemnon se résoudra à sacrifier sa fille pour se prouver à lui même qu’il ne craint pas le jeune guerrier qui est plus puissant que lui et qui effectivement l’a fait nommer « chef de vingt rois ses rivaux » (Acte III, scène 5, v. 967). Mais son amour pour sa fille, qui expose une incestuosité latente que certains spectateurs ne crurent pas bienséante, trouve une autre solution à la fin de l’Acte IV. Iphigénie vivra, s’enfuira, et ne reverra jamais Achille : « elle vivra pour un autre que lui » (Acte IV, scène 8, v. l459-1460). Furieux, Achille menace de tuer à la fois le prêtre qui prononça l’oracle et le père infanticide − un acte qui équivaut au régicide − et ceci au moment où l’armée menace de déclencher un tumulte à la nouvelle de la fuite imminente de leur victime. « Ce n’est plus un vain peuple en désordre assemblé », crie une des femmes de Clytemnestre dans son effroi : « C’est d’un zèle fatal tout le camp aveuglé » (Acte V, scène 3, v. l623-1624). Dans le paroxysme de cette crise sacrificielle, une confrontation sanglante explose sur l’autel sacré entre les guerriers d’Achille, protégeant la vie d’Iphigénie, et les soldats grecs « en fureur » (Acte V, scène 3, v.1628, 1643), tandis que Agamemnon, dépossédé de son pouvoir, détourne les yeux du meurtre à venir, qui présage tout aussi bien la dissolution de l’ État grec (Acte V, scène 3, v. 1627 ; Acte V, scène 5, v. 1709-1710).
****
Au point culminant de cette anarchie, Calchas apparaît pour reprendre son oracle et révéler qu’Ériphile est la fille illégitime d’Hélène et celle qui doit mourir. Citant Calchas plus tard, Ulysse décrit cette scène de révélation :
Vous, Achille, (a-t-il dit) et vous, Grecs, qu’on m’écoute.
Le Dieu qui maintenant vous parle par ma voix
M’explique son oracle, et m’instruit de son choix.
Un autre sang d’Hélène, une autre Iphigénie
Sur ce bord immolé y doit laisser sa vie…
Elle me voit, m’entend, elle est devant vos yeux,
Et c’est elle, en un mot, que demandent les Dieux.
Le Dieu qui maintenant vous parle par ma voix
M’explique son oracle, et m’instruit de son choix.
Un autre sang d’Hélène, une autre Iphigénie
Sur ce bord immolé y doit laisser sa vie…
Elle me voit, m’entend, elle est devant vos yeux,
Et c’est elle, en un mot, que demandent les Dieux.
(Acte V, scène 6, v. 1746-1750, 1759-1760)
L’ambiguïté de cette phrase − « un autre sang d’Hélène », et non plus, « une fille du sang d’Hélène », comme au premier Acte (Acte I, scène 1, v. 59) − doit voiler le fait que Racine a trouvé ce que Barthes appelle une « solution élégante » (1965 : 111) à l’impasse de la crise sacrificielle : celle d’inventer « une autre Iphigénie ».
Ce tour de prestidigitation est efficace parce qu’il manque à Ériphile ce qu’Iphigénie possède : un père et un fiancé puissants, une famille royale, et une armée pour la protéger. De naissance inconnue, d’origine mystérieuse, comme Oedipe, Ériphile est tourmentée par son abjection :
Remise dès l’enfance en des bras étrangers,
Je reçus et je vois le jour que je respire,
Sans que mère ni père ait daigné me sourire.
J’ignore qui je suis; et pour comble d’horreur,
Un oracle effrayant m’attache à mon erreur,
Et quand je veux chercher le sang qui m’a fait naître,
Me dit que sans périr je ne me puis connaître.
Je reçus et je vois le jour que je respire,
Sans que mère ni père ait daigné me sourire.
J’ignore qui je suis; et pour comble d’horreur,
Un oracle effrayant m’attache à mon erreur,
Et quand je veux chercher le sang qui m’a fait naître,
Me dit que sans périr je ne me puis connaître.
(Acte II, scène 1, v. 424-40)
Étrangère à elle-même, « une fille sans nom » (Acte II, scène 5, v. 708), Ériphile est le butin de la victoire d’Achille sur Lesbos, une captive qui se nomme, « une vile esclave » (Acte II, scène 1, v. 451). Pour voiler le lien entre l’impuissance et la sacrifiabilité et pour légitimer son « meurtre », Racine construit le personnage d’Ériphile comme « le contraire symétrique » d’Iphigénie, un monstre de naissance illégitime et de désir interdit pour Achille (Barthes 1965 : 110). Tout comme Phèdre, Ériphile est possédée par un amour pour son « vainqueur sauvage » (Acte II, scène 1, v. 489) qui lui fait horreur, comme elle l’avoue à Doris, sa seule confidente :
Rappellerai-je encor le souvenir affreux
Du jour qui dans les fers nous jeta toutes deux ?
Dans les cruelles mains par qui je fus ravie
Je demeurai longtemps sans lumière et sans vie…
J’entrai dans son vaisseau, détestant sa fureur,
Et toujours détournant ma vue avec horreur.
Je le vis : …Je sentis le reproche expirer dans ma bouche.
Je sentis contre moi mon cœur se déclarer…
Du jour qui dans les fers nous jeta toutes deux ?
Dans les cruelles mains par qui je fus ravie
Je demeurai longtemps sans lumière et sans vie…
J’entrai dans son vaisseau, détestant sa fureur,
Et toujours détournant ma vue avec horreur.
Je le vis : …Je sentis le reproche expirer dans ma bouche.
Je sentis contre moi mon cœur se déclarer…
(Acte II, scène 1, v. 487-490, 495-499) [12]
Le désir obsessif d’Ériphile pour son ravisseur, le conquérant de Lesbos, où elle fut élevée, constitue « une faiblesse » (Acte II, scène 1, v. 478) dans l’économie racinienne, une faute punissable, comparable à celle d’Hippolyte. Cependant, l’amour de la captive pour son capteur, que Racine aurait pu fonder sur le rapport d’Achille à Briseïs chez Homère et Ovide; et plus exactement, l’idée qu’une femme aime son conquérant parce qu’il la dérobe à son autonomie ne représente pas seulement un phantasme phallocentrique, elle prend un sens politique particulier en 1674, pendant les succès militaires de Louis XIV, et autorise − voire sentimentalise − une érotique impérialiste du pouvoir.
La passion-sans-espoir d’Ériphile pour Achille signale aussi un désir d’assumer l’identité de son double, prendre ce qu’elle n’a pas, et de détruire Iphigénie, et par métonymie, sa famille et son ethnie, les Grecs. Ériphile révèlera donc les « complots criminels » pour sauver Iphigénie de Calchas et des Grecs (Acte IV, scène 1, v. 1130-1132) ; et ceux-ci arrêtent sa fuite d’Aulide et mènent la vierge vertueuse à l’autel sacrificiel. Cet acte sert à susciter l’antipathie nécessaire du spectateur pour Ériphile, une attitude renforcée par la générosité d’Iphigénie, qui s’apitoie sur le sort d’Ériphile, et exige qu’Achille mette la captive en liberté, même après sa prise de conscience horrifiée qu’elle a aidé une rivale (Acte II, scène 5, v. 678-722 ; Acte III, scène 5, v. 854-896). Ce faisant, Racine valorise Iphigénie comme idéal de féminité que l’Autre convoite avec une intensité meurtrière. Nonobstant les nombreuses trahisons qui ont lieu dans cette pièce [13] , celles d’Ériphile sont dénoncées comme monstrueuses : « Ah ! savez-vous le crime, et qui vous a trahie / Madame ? Savez-vous quel serpent inhumain / Iphigénie avait retiré dans son sein ? » (Acte V, scène 4, v. l674-1676). Cette trahison fournit encore un motif contre Ériphile, comme Racine le suggère dans sa Préface: « … tombant dans le malheur où cette amante jalouse voulait précipiter sa rivale, [Ériphile] mérite en quelque façon d’être punie, sans être pourtant tout à fait indigne de compassion » (Clarac 1962 : 225).
Racine ira même plus loin pour noircir Ériphile en lui attribuant la volonté d’empirer la discorde dans le couple, dans la famille, et dans l’État. Elle guette donc des signes de conflit entre les membres de la famille d’Agamemnon, qui pourraient dénouer les fiançailles (Acte II, scène 8, v. 761 sq. ; Acte IV, scène 1, v. 1118-1124), et elle cherche des moyens de répandre la violence parmi les Grecs pour venger le destin de Lesbos et pour empêcher la destruction de Troie, dont elle est, d’après une prophétie, originaire. Elle partage cette vision exaltée avec sa confidente, Doris :
Que d’encens brûlerait dans les temples de Troie,
Si troublant tous les Grecs, et vengeant ma prison,
Je pouvais contre Achille armer Agamemnon ;
Si leur haine, de Troie oubliant la querelle,
Tournait contre eux le fer qu’ils aiguisent contre elle,
Et si de tout le camp mes avis dangereux
Faisaient à ma patrie un sacrifice heureux !
Si troublant tous les Grecs, et vengeant ma prison,
Je pouvais contre Achille armer Agamemnon ;
Si leur haine, de Troie oubliant la querelle,
Tournait contre eux le fer qu’ils aiguisent contre elle,
Et si de tout le camp mes avis dangereux
Faisaient à ma patrie un sacrifice heureux !
(Acte IV, scène 1, v. 1134-1140)
Pourtant, ce désir de semer le désordre a été signalé dès le début de la pièce par son nom — épelé avec un « i grec », le mot « Ériphyle » signifie « tribu désunie » ; ou alors, comme Racine l’écrit, avec un « i », le nom évoque le monstre vénéneux, Eriffila, dans le Roland Furieux de l’Arioste. Tout aussi bien, Éris-philia, « l’amante de la discorde », se rattache à Éris, la déesse qui jeta la pomme que Paris présenta à Aphrodite, la déesse qui lui avait promis la plus belle femme (Hélène), et non pas à Athéna, dont l’injure et donc la haine mèneront à la guerre de Troie [14] . Par conséquent, aux niveaux symbolique et psychologique, Racine « accuse » Ériphile de la discorde dans la famille et dans l’État, même si, à vrai dire, c’est l’opposition de la famille d’Agamemnon et d’Achille à l’exécution de la prophétie qui crée l’impasse et exige l’invention d’une victime sacrifiable.
Ériphile satisfait donc la double fonction du pharmakos, poison et remède, katharma et katharsis (Derrida 1972). Mais le poison du dés-ordre, qui obséda le XVIIe siècle français, a une spécificité genrée, comme nous le signalent les traités misogynes de la longue Querelle des Femmes (Olivier 1683), qui continuent à identifier la femme avec Éve, source du dérèglement édénique et de la chute de l’homme [15] . Les femmes de cette première modernité sont associées avec les sorcières, dont 50000 furent brûlées vives par l’Église et la justice en complicité avec la médecine ; les violences de la nature, que les découvertes de la révolution scientifique s’efforcèrent de contrôler ; avec l’animalité et une sexualité insatiable, que la domesticité conjugale devait maîtriser; et avec un corps (politique) indiscipliné, que le pouvoir monarchique absolutiste devait surveiller, punir, et faire rentrer dans l’ordre. Là où « l’aimable » (Acte II, scène 1, v. 409) Iphigénie déplace tout désir sur le père et figure le sujet idéal du politique, son double monstrueux incarne le désordre sauvage qui doit être sacrifié sur l’autel de l’État patriarcal.
*****
Le lien entre le désir et le désordre qu’Ériphile incarne définit sa différence d’avec Iphigénie et sa ressemblance à Hélène, sa soi-disante mère. Là où Ériphile s’efforce de « troubler tous les Grecs » (Acte IV, scène 1, v. 1135), « la folle amour » d’Hélène « trouble et l’Europe et l’Asie » (Acte IV, scène 4, v. l278), comme Clytemnestre le constate avec colère, en essayant de se dissocier de sa soeur et donc de son propre héritage familial passionnel (Acte IV, scène 4, v. 1269-1280). Identifiée avec « la perfide Troie » (Acte I, scène 5, v. 382), et donc le barbare, le sensuel, l’oriental [16] , l’Hélène de Racine est la source de « l’opprobre éternel » de la Grèce (Acte I, scène 2, v. 228) par son refus de limiter ses désirs aux lois des hommes qui sacralisent le mariage, la famille, et l’État.
La transgression d’Hélène a incité « la communauté des andres » à contrôler sa sexualité par la création d’un pacte entre hommes, une version de la thèse d’Engels selon laquelle l’État est fondé pour contrôler les femmes (Engels 1972) [17] . Ulysse rappelle à un Agamemnon paralysé par ses conflits :
…les serments
Que d’Hélène autrefois firent tous les amants,
Quand presque tous les Grecs, rivaux de votre frère,
La demandaient en foule à Tyndare son père [.]
De quelque heureux époux que l’on dût faire choix,
Nous jurâmes dès lors de défendre ses droits;
Et si quelque insolent lui volait sa conquête,
Nos mains du ravisseur lui promirent la tête.
Que d’Hélène autrefois firent tous les amants,
Quand presque tous les Grecs, rivaux de votre frère,
La demandaient en foule à Tyndare son père [.]
De quelque heureux époux que l’on dût faire choix,
Nous jurâmes dès lors de défendre ses droits;
Et si quelque insolent lui volait sa conquête,
Nos mains du ravisseur lui promirent la tête.
(Acte I, scène 3, v. 300-306)
Quand son frère, Ménélas a souffert un « honteux affront » (Acte IV, scène 6, v. 1391) par « le crime adultère » de sa femme (Acte IV, scène 4, v. 1269), ce fut Agamemnon et lui seul, insiste Ulysse, qui convoqua les rivaux à honorer leur voeu et, par la même, devint le fondateur de l’État :
Mais sans vous, ce serment que l’amour a dicté,
Libres de cet amour, l’aurions-nous respecté ?
Vous seul…Nous avez fait laisser nos enfants et nos femmes.
Et quand, de toutes parts assemblés en ces lieux,
L’honneur de vous venger brille seul à nos yeux ;
Quand la Grèce déjà vous donnant son suffrage,
Vous reconnaît l’auteur de ce fameux ouvrage;
Que ses rois qui pouvaient vous disputer ce rang
Sont prêts, pour vous servir, de verser tout leur sang,
Le seul Agamemnon, refus[e] la victoire…
Et dès le premier pas se laissant effrayer,
Ne commande les Grecs que pour les renvoyer.
Libres de cet amour, l’aurions-nous respecté ?
Vous seul…Nous avez fait laisser nos enfants et nos femmes.
Et quand, de toutes parts assemblés en ces lieux,
L’honneur de vous venger brille seul à nos yeux ;
Quand la Grèce déjà vous donnant son suffrage,
Vous reconnaît l’auteur de ce fameux ouvrage;
Que ses rois qui pouvaient vous disputer ce rang
Sont prêts, pour vous servir, de verser tout leur sang,
Le seul Agamemnon, refus[e] la victoire…
Et dès le premier pas se laissant effrayer,
Ne commande les Grecs que pour les renvoyer.
(Acte I, scène 3, v. 307-308, 310-317, 319-320)
La menace qui pèse sur cet État naissant, la famille patriarcale, et le couple monogame, à cause du « crime » d’Hélène, dévoile la logique de la femme à tuer : Ériphile ne sera pas sacrifiée au lieu d’Iphigénie ; au niveau symbolique, elle sera punie en tant que fille d’Hélène − son substitut métonymique − ce qui veut dire que le “crime” d’Hélène serait vengé avant que les Grecs ne partent vers Troie. En fait, cet acte de vengeance a été déjà réalisé par la destruction de Lesbos, ce qu’Agamemnon démontre à Achille dès le premier Acte :
…votre valeur, qui nous a devancés
N’a-t-elle pas pris soin de nous venger assez ?
Les malheurs de Lesbos, par vos mains ravagée,
Épouvantent encore toute la mer Égée.
Troie en a vu la flamme; et jusque dans ses ports,
Les flots en ont poussé le débris et les morts.
Que dis-je ? Les Troyens pleurent une autre Hélène
Que vous avez captive envoyée [ici] à Mycènes.
N’a-t-elle pas pris soin de nous venger assez ?
Les malheurs de Lesbos, par vos mains ravagée,
Épouvantent encore toute la mer Égée.
Troie en a vu la flamme; et jusque dans ses ports,
Les flots en ont poussé le débris et les morts.
Que dis-je ? Les Troyens pleurent une autre Hélène
Que vous avez captive envoyée [ici] à Mycènes.
(Acte I, scène 2, v. 231-238)
Cette identification métonymique et symbolique entre Lesbos et Troie au premier Acte, et donc entre Ériphile et Hélène, confirme la notion que l’ordre patriarcal joue et rejoue le meurtre de la femme dite en dés-ordre, en dehors de la loi du père. Dans l’Iphigénie en Aulide, la terreur de cette femme/mère érotique est le fondement même de l’État phallique, qui est soutenu et maintenu en place par une violence meurtrière contre les femmes désirantes et leurs filles.
Cependant, Ériphile ne se soumet pas gentiment à sa mort. Dans la dernière scène de la pièce, quand la foule se précipite pour réaliser la nouvelle prophétie (Acte V, scène 6, v. 1769), Ériphile refuse d’être souillée par ce qu’elle appelle les « mains profanes » de Calchas, et « Furieuse elle vole, et sur l’auteur prochain / Prend le sacré couteau, le plonge dans son sein » (Acte V, scène 6, v. 1775-1776). Rejetant la soumission d’une Iphigénie, Ériphile commet ce que Nicole Loraux qualifierait de « suicide masculin » (1985). Dans un refus Antigonien de justifier et de légitimer le sacré, et la violence rituelle qui lie le politique et le social, Ériphile effectue une déviation de la norme qui brouille la division des sexes [18] .
Mais ce n’est que pour un moment. De façon paradoxale, voire perverse, la mort d’Ériphile produit le résultat que les Grecs désiraient dès le début − le secours de la nature − ce qui réaffirme le pouvoir du sacré et stabilise de nouveau l’État, tout le contraire de ce qu’elle voulait. Ulysse fait le récit de ce dénouement miraculeux :
À peine son sang coule et fait rougir la terre,
Les Dieux font sur l’autel entendre le tonnerre,
Les vents agitent l’air d’heureux frémissements,
Et la mer leur répond par ses mugissements.
Le ciel brille d’éclairs, s’entr’ouvre, et parmi nous
Jette une sainte horreur qui nous rassure tous.
Les Dieux font sur l’autel entendre le tonnerre,
Les vents agitent l’air d’heureux frémissements,
Et la mer leur répond par ses mugissements.
Le ciel brille d’éclairs, s’entr’ouvre, et parmi nous
Jette une sainte horreur qui nous rassure tous.
(Acte V, scène 6, v. 1777-1784)
Comme le pharmakos, donc, Ériphile semblait causer des dégâts irréparables au couple et à la famille, la monarchie et l’État, mais en fait, elle finirait par consolider et renforcer le social, le politique, et leurs institutions. Est-ce que cela veut dire que toute opposition, tout résistance soit condamnée à rendre plus inébranlable l’ordre patriarcal ? Ou est-ce ce que le futur historiographe de Louis XIV voudrait faire croire aux spectateurs dans une pièce que certains considèrent la plus royaliste de son œuvre ?
Néanmoins, au moment où les soldats s’apprêtent à partir vers Troie, Agamemnon, Clytemnestre, et Achille vont se réunir avec Iphigénie pour célébrer leur « commun bonheur » (Acte V, scène 6, v. 1790), le dénouement d’Iphigénie en Aulide sonne faux. Les Grecs ne sont plus immobilisés, mais ils seront éventuellement détruits par la mer/mère avec lesquelles Ériphile et Hélène, Lesbos et Troie sont identifiées — tout comme Clytemnestre l’espérait :
Quoi ! Pour noyer les Grecs, et leurs mille vaisseaux,
Mer, tu n’ouvriras pas des abîmes nouveaux !
Les vents, les mêmes vents, si longtemps accusés,
Ne te couvriront pas de ses vaisseaux brisés ?
(Acte V, scène 4, v. 1683-1684, 1687-1688)
Mer, tu n’ouvriras pas des abîmes nouveaux !
Les vents, les mêmes vents, si longtemps accusés,
Ne te couvriront pas de ses vaisseaux brisés ?
(Acte V, scène 4, v. 1683-1684, 1687-1688)
Comme les spectateurs le savaient bien aussi, Achille trouvera la mort à Troie, et Agamemnon la sienne par Clytemnestre, la mère désirante d’Oreste.
Cependant, c’est l’image d’Iphigénie seule « [qui] pleure son ennemi » (Acte V, scène 6, v. 1789-1790), qui remet le dénouement heureux, en fin de compte, le plus en question. Ces larmes pourraient s’interpréter comme signe de compassion pour Ériphile, cette autre avec laquelle elle était « unie », dit Doris (Acte II, scène 1, v. 410), une sœur dont Iphigénie disait ne pas supporter d’être séparée : « Vous ne pouviez sans moi demeurer à Mycènes ;/ Me verra-t-on sans vous partir avec la Reine ? », demande-t-elle à Ériphile à l’Acte II (Acte II, scène 5, v. 665-666). D’après mon interprétation, elle serait « la seule Iphigénie » (Acte V, scène 6, v. 1789-1790) qui reste, en deuil pour une perte irréparable, incontournable — la destruction de l’autre dans son fort intérieur, son double réprimé, le moi qui aurait pu être Ériphile mais qui est sacrifié en faveur de la fille idéale du père. Après tout, si Ériphile est à la fois « une autre Iphigénie » et « une autre Hélène », comme le dit le texte de Racine (Acte I, scène 2, v. 237), il s’ensuit qu’Iphigénie ressemble et à Ériphile et à Hélène, sa tante, et au delà du dénouement de la pièce, à Clytemnestre qui prend Égisthe dans son lit. Si cette logique tient, la différence radicale entre la vertueuse Iphigénie, qui soutient le nom-du-père absolu, et la monstrueuse Ériphile, qui incarne le dés-ordre et le désir illégitime, serait fausse, voire inexistante. La mise en scène de Racine viserait à (re)construire et à (re)confirmer les différences entre les femmes honnêtes et malhonnêtes, bonnes et monstrueuses dans l’idéologie des sexes du XVIIe siècle, et ce faisant, à nier la ressemblance entre les femmes et leur destinée sacrificielle commune. Car toutes deux − Ériphile et Iphigénie − sont victimes de l’ordre patriarcal.
C’est avec une pitié endeuillée que nous aussi, lectrices et lecteurs, nous pouvons faire retour sur cette Ériphile — l’étrangère, l’esclave qui finit par défier le sort que « la communauté des andres » essaie de lui imposer. Mais Hélène peut aussi servir à nous rappeler, de façon anachronique et métaphorique, que le vaisseau de l’État phallique est plus fragile qu’il ne se dit, qu’il peut vaciller sur la crête désordonnée des désirs des femmes, et qu’il n’atteindra peut-être jamais la terra firma si les vagues de filles illégitimes ne disparaissent pas [19] .
***
Il faut donc nous remémorer, il faut « lutter contre les politiques de l’oubli », comme Nicole Loraux le souligne dans un commentaire sur Vichy (1988a : 22). Mais cette lutte ne doit pas se limiter à un « deuil gémissant », que Loraux associe avec le féminin, mais à un deuil combattant, militant qui se rattache à l’histoire de la résistance des femmes dans le double sens du mot « histoire » : récit de fiction et récit de facticité, de véridicité. En d’autres termes, pour mettre au clair mon différend d’avec Nicole Loraux, il s’agirait donc de l’histoire du féminisme, avec toutes les significations et les manifestations de ce mouvement historique, et non pas de la quête du féminin.
A vrai dire, je n’ai trouvé que deux références au féminisme dans les textes de Loraux, qui, par ailleurs, ne passaient pas sous silence ses engagement politiques, que ce soit contre Vichy ou pour les immigrés (Loraux 1988b ; 1996). Et ces deux références, qui se trouvent dans Façons tragiques de tuer une femme, sont toutes deux ambiguës par rapport au je qui parle. Nicole Loraux constate que dans toute enquête, il faut « récuser ou…modifier, chemin faisant, ses hypothèses de départ, surtout lorsqu’on ne les adoptait qu’avec une pensée de derrière — en l’occurrence, la conviction qu’il faut à tout prix éviter l’inutile dilemme du féminisme et de la misogynie » (Loraux 1985 : 99), mais ce disant, elle ne nous donne aucune précision sur ce dilemme, dit inutile. Dans une note, elle avance l’hypothèse que « si la tragédie est féministe, elle l’est à la façon de ces féministes dont parle P[ierre] Darmon, qui “régénèrent le genre féminin dans un bain de sang” » (119). Ici, le sujet qui parle semble à la fois se rapprocher et prendre ses distances du féminisme, en lui préférant, même ici, la notion du « féminin ».
Certes, Nicole Loraux a problématisé ce concept heuristique de l’opérateur féminin constamment; et certes elle s’efforce « de ne pas succomber au vertige essentialiste de l’assimilation » (Loraux 1989 : 25). Mais, en même temps, elle se sent obligée de « généraliser sur le terrain très homogène des opérations imaginaires », et elle aboutit à la conclusion − structuraliste − que « par delà les diversités des mythes, c’est bien le mythe qui constitue le féminin » (Loraux 1989 : 231). Que l’historienne se situe ici à l’arrière plan en faveur et de la structuraliste et de l’amatrice de la psychanalyse peut certainement se comprendre, vu les tentatives lorauxiennes − par exemple, dans son étude sur Aspasie (Loraux 2001) − de chercher les femmes, leurs traces fuyantes, dans et à travers les œuvres des hommes. « Quelle place reste-t-il pour les femmes », se demande-t-elle dans Les Enfants d’Athéna (Loraux 1981b : 12) ? C’est ce manque, cette aporie qui expliquent, peut-être, son saut vers la métaphore essentialiste, en comparaison à la métonymie contextuelle et historique − pour reprendre la distinction de Jacobson (1956) − un saut de compensation qui finit par identifier le féminin, en tant qu’opérateur, avec l’excès, la sédition, la rupture, l’irrationnel, l’incontrôlable, en somme, avec tout ce qui dit non et qui inquiète et qui déstabilise [20] . Que cette série de notions soit identique aux valeurs de la soi-disant « écriture féminine » de la période post 1968 chez Cixous, Irigaray, et Kristeva [21] , par exemple, et chez Lacan et Derrida confirme de nouveau la vérité incontournable que nous intériorisons et nous ré-écrivons les discours de notre contexte ; et Nicole Loraux, une partie essentielle, voire remarquable, d’un certain contexte académique intellectuel français, ne saurait être une exception [22] . La survalorisation de la différence [23] , qui date de cette époque, et qui donne le beau rôle au féminin d’ébranler le masculin et son système symbolique, finit par répéter et retrouver la même − la seule − histoire : celle de l’essentiel. Ce faisant, « le féminin » soutient, de nécessité, la binarité que Loraux récusa par principe et par pratique. De plus, ce féminin différentiel, essentialiste ne laisse aucune place pour la soumission et la collaboration d’une Iphigénie, ni donc le va-et-vient métonymique et historique des femmes tiraillées entre la conformité et l’opposition, la complicité et la résistance — ce que nous vivons toutes et tous chaque jour. Je rejoins donc Loraux dans sa déclaration de principes, où elle préconise la polyphonie, contre le un. L’avenir sera fait de pluralité, dit-elle (Loraux 2005 : 23, 27), une pluralité que j’aimerais voir fonder sur l’historique et l’anthropologique, le contextuel et le métonymique de sorte qu’on puisse dire les femmes dans toute leur complexité conflictuelle, et non pas les voir limitées à une essence, forcement liée à l’ontothéologique. Dans notre deuil dialogique au cours de ce colloque, que cette polyphonie des voix compose le chant des femmes dans leurs différences plurielles pour celle − Nicole Loraux − qui continue à être parmi et entre nous.
Bibliographie
Alaux, J. et al. 2005. Les Voies traversières de Nicole Loraux : une helléniste à la croisée des sciences sociales. EspacesTemps/Les Cahiers Clio 87/88. Paris.
Barthes, R. 1965. Pour Racine. Paris.
Bouchel, L. 1615. Bibliothèque du droit français. Paris.
Clarac, P. 1962. J. Racine. Œuvres complètes. Paris.
Derrida, J. 1972. « La Pharmacie de Platon », La Dissémination. Paris, 69-197.
Descotes, M. 1969. Racine. Bordeaux.
Engels, F. 1972. The Origin of the Family, Private Property and the State. Éd. Evelyn Reed. New York.
Goldmann, L. 1955. Le Dieu Caché : Étude sur la vision tragique dans les Pensées de Pascal et dans le théâtre de Racine. Paris.
Hall, E. 1989. Inventing the Barbarian : Greek Self-Definition Through Tragedy. Oxford.
Haraway, D. 1991. « Situated Knowledges : The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective ». In D. Haraway, Simians, Cyborgs, and Women : The Reinvention of Nature. New York : 183-201.
Jakobson, R. 1956. « Two Aspects of Language and Two Types of Aphasic Disturbances ». In R. Jakobson and M. Halle, Fundamentals of Language. The Hague : 54-82.
Jameson, F. 1981. The Political Unconscious : Narrative as Socially Symbolic Act. Ithaca.
Kristeva, J. 1974. Pour une révolution poétique. Paris.
Loraux, N. 1981a. L’Invention d’Athènes. Histoire de l’oraison funèbre dans la « cité classique ». Paris.
1981b. Les Enfants d’Athéna. Idées athéniennes sur la citoyenneté et la division des sexes. Paris.
1985. Façons tragiques de tuer une femme. Paris.
1988a. Politiques de l’oubli. Paris.
1988b. « Pour quel consensus ». Le Genre Humain 18 : 9-23.
1989. Les Expériences de Tirésias. Le féminin et l’homme grec. Paris.
1990. Les Mères en deuil. Paris.
1993. « Éloge de l’anachronisme en histoire ». Le Genre Humain 27 : 23-39.
1996. Né de la terre : Mythe et politique à Athènes. Paris.
2001. « Aspasie, l’étrangère, l’intellectuelle ». Clio HFS 13 : 17-42.
2005. La Tragédie d’Athènes. La Politique entre l’ombre et l’utopie. Paris.
Olivier, J. 1683. Alphabet de l’imperfection et malice des femmes. Paris
Pateman, C. 1988. The Sexual Contract. Stanford.
Stanton, D. C. 1989. « Difference on Trial : A Critique of the Maternal Metaphor in Cixous, Irigaray, and Kristeva ». In J. Allen and I. M. Young (eds.), The Thinking Muse : Feminism and Modern French Philosophy. Bloomington, Indiana : 156-179.
Stanton, D. C. 2000. « From the Maternal Metaphor to Metonymy and History : Seventeenth-Century Discourses of Maternalism and the Case of Sévigné ». In B. Norman (ed.), The Mother In/And French Literature. Columbia South Carolina.
Footnotes
[ back ] 1. Pour une analyse de cette notion, voir Situated Knowledges, essai important de Haraway 1991.
[ back ] 2. La conscience de la position « construite » de tout lecteur ou lectrice, est manifeste à plusieurs reprises chez Loraux, e.g. : « C’est volontairement, donc, que l’on a assumé la peu lyrique position de lecteur. Mais il faut bien nous y résoudre : nous n’occuperons jamais la place des spectateurs athéniens du Ve siècle » (Loraux 2005 : 103). Voir aussi Loraux 1993.
[ back ] 3. Voir Stanton 1989 et 2000.
[ back ] 4. Expressions de femmes, expression du féminin
[ back ] 5. La pièce est écrite pour célébrer la victoire de Louis XIV en Flandres en l674 ; elle fut jouée dans l’Orangerie qui avait été décorée avec d’immenses représentations du soleil pour glorifier le roi. Racine deviendra l’historiographe royal en l677. Robinet est parmi ceux qui ont décrit la réception de la pièce : « …pour lors, la cour toute pleine / De pleureurs, fit une autre scène / Où l’on vit maints des plus beaux yeux, / Voire des plus impérieux, / Pleurer sans aucun artifice / Sur ce fabuleux sacrifice » (Descotes 1969 : 20). Le succès d’ Iphigénie en Aulide est d’autant plus frappant dans un siècle où plusieurs mises en scène de « ce fabuleux sacrifice » furent montées. Mais ce succès peut aussi se lier à la décision de Racine de renoncer à sa tentative initiale de dépeindre la femme sacrificatrice de l’Iphigénie en Tauride et de ré-écrire pour la cour de Louis le mythe de la femme sacrifiée. Cette lecture de la pièce de Racine est tirée de mon étude, « The Daughters’ Sacrifice and the Paternal Order in Racine’s Iphigénie en Aulide, dans mon livre, Women Writ, Women Writing : Gendered Discourses and Differences in Seventeenth-Century France (2012 : Chicago)
[ back ] 6. Au XVIIe siècle, plaire a le sens fort de captiver, enchanter, ravir.
[ back ] 7. Ce faisant, Racine refuse le massacre d’Iphigénie chez Eschyle et Sophocle (224) (Clarac 1962 :224).
[ back ] 8. Racine ne révèle pas les raisons pour lesquelles la victime doit être Iphigénie, et non pas Oreste, par exemple, qui lui aussi est du sang d’Hélène, par sa mère Clytemnestre, la sœur de la belle adultère ; mais en passant sous silence le fait qu’Agamemnon avait tué la biche de Diane, d’où l’exigence d’une vierge comme rétribution pour l’animal femelle, Racine fait du roi une victime innocente de l’arbitraire des dieux.
[ back ] 9. Sur Clytemnestre voir Loraux 1989 : 227.
[ back ] 10. En fait, elle est beaucoup plus soumise que les héroïnes d’Euripide et de Jean de Rotrou, l’auteur d’une Iphigénie en Aulide (1640), car toutes deux acceptent la mort au nom d’une culture hellénique ou de l’État-Nation.
[ back ] 11. Concept que j’emprunte à Fredric Jameson (1981).
[ back ] 12. Ce fantasme rappelle la fameuse tirade d’Andromaque, décrivant le moment où elle devient prisonnière de guerre de Pyrrhus (Acte III, scène 8, v. 992-1006). Voir aussi la confession de Phèdre à Hippolyte (Acte I, scène 3, v. 269 sq.).
[ back ] 13. Arcas, par exemple, révèle à Clytemnestre et à Achille le secret d’Agamemnon sacrifier sa fille mais cette trahison est réduite à une « heureuse imprudence » (Acte IV, scène 10, v. 1473).
[ back ] 14. Selon Loraux, Éris, « la hideuse », est souvent associée avec Hélène ; voir Loraux 1989 : 240-241. D’ailleurs, Loraux constate que les femmes et les esclaves sont des figures pour penser le désordre dans la cité grecque (279).
[ back ] 15. D’où aussi la notion répandue que toute infraction de la « loi » salique mènerait à la ruine de l’État (Bouchel 1615 : III, 99).
[ back ] 16. Je tiens à remercier Ruth Skodel pour la notion que Troie représente « l’autre oriental » de la Grèce et que Lesbos est associé avec l’élégance, la décadence, et donc la sensualité oriental(ist)e. Voir aussi Hall 1989.
[ back ] 17. Voir aussi la notion de contrat pour établir « the law of male sex right » (« la loi du droit sexuel masculin ») fondamentale à l’ordre patriarcal que Pateman 1988 qualifie de fraternel (et non pas paternel).
[ back ] 18. Sur l’importance de cette notion dans la tragédie, voir Loraux 1985 : 13, 99.
[ back ] 19. Je suis donc tout à fait d’accord qu’Hélène représente « la chose sexuelle » pour les Grecs, mais en désaccord, qu’il s’agisse du « neutre, bien au delà de la différence des sexes », selon Loraux 1989 : 233 ; sur Hélène, voir 232-252.
[ back ] 20. Voir Catherine Darbo Peschanski, « La Belle Complexité », dans Les Voies traversières de Nicole Loraux (Alaux et al. 2005 : 37); voir aussi l’apologie pour ce féminin, en opposition à la prise de position militante ou polémique de la cause des femmes chez Loraux, d’après Pascal Payen (« Dans cet entre-deux du présent et du passé : une écriture de l’histoire ? ». In Alaux et al. 2005 : 44).
[ back ] 21. Les signifiés de cet opérateur féminin me rappellent, en fait, « le sémiotique » de Kristeva 1974.
[ back ] 22. Et ceci, en dépit des déplacements − presque annuels − de Loraux aux États-Unis, notamment à Cornell University.
[ back ] 23. Voir Stanton 1989.