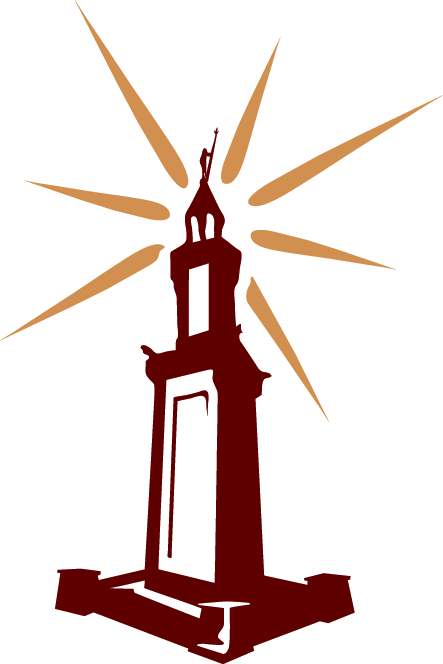« Tout n’est pas possible absolument lorsqu’on applique au passé des questions du présent, mais on peut du moins tout expérimenter à condition d’être à tout moment conscient de l’angle d’attaque et de l’objet visé. Reste que, à travailler en régime d’anachronisme, il y a sans doute encore plus à tirer de la démarche qui consiste à revenir vers le présent, lesté de problèmes anciens [1] ».
« … la pólis égalitaire du consensus, dont les propositions essentielles sont disséminées dans la totalité du discours grec, existe parce que les cités en réalité se divisent (parce que, dans les grandes cités et dans les petites, la décision et le combat, ces deux objets des historiens, soudain interfèrent). À la cité divisée, elle sert d’idéologie, parce que sa figure rassurante nie jusqu’à la possibilité de penser les divisions réelles [2] ».
Ces deux fragments de Nicole Loraux placés en tête de notre texte indiquent d’emblée que celui-ci se situe à la croisée de deux grandes préoccupations de l’historienne que nous célébrons. À savoir, l’expérimentation avec des principes inédits dans le cadre de la recherche historique et l’« oubli mémorable » qu’une scission civique spécialement déchirante, la stasis, peut représenter pour un peuple.
En suivant ces principes aussi encourageants que préventifs, nous nous situerons dans une époque toute récente pour commencer notre parcours.
Le 28 juillet 2006, soixante-dix ans après le soulèvement militaire qui marqua le début de la guerre civile, le 18 juillet 1936, le gouvernement socialiste espagnol présidé par Mr. Rodríguez Zapatero a présenté un projet de loi qui a pour objet :
« …la reconnaissance et l’extension des droits en faveur des personnes ayant subi des persécutions ou des violences, pour des raisons politiques, idéologiques ou de croyances religieuses, pendant la guerre civile et la dictature. Elle vise à promouvoir la réparation morale des victimes et la récupération de leur mémoire personnelle et familiale, et à adopter des mesures complémentaires destinées à supprimer des éléments facteurs de division entre les citoyens et ce, dans le but de promouvoir la cohésion et la solidarité entre les différentes générations d’Espagnols, quant aux principes, aux valeurs et aux libertés constitutionnelles. »
Ce projet, finalement approuvé lors de la séance du Congrès tenue le 31 octobre 2007 − en dépit du vote contre des Populares (du Partido Popular) −, comporte des mesures dont la précision peut être illustrée par les quatre articles suivants :
« Article 7. … application des indemnisations en faveur des personnes ayant souffert d’emprisonnement
Toute personne justifiant avoir subi une privation de liberté dans des établissements pénitentiaires ou dans des bataillons disciplinaires […] aura droit à l’octroi d’une indemnisation versée en une seule fois à hauteur du barème qui suit :
Durée d’emprisonnement de trois ans ou au-delà : 6.010,12 €.
Par tranche de trois années complètes supplémentaires : 1.202,02 €.
En cas de décès de l’auteur du droit à cette indemnisation et si, au 31 décembre 1990, ledit auteur avait pu atteindre l’âge de soixante ans ou plus, le conjoint survivant aura le droit de percevoir ladite indemnisation […] ».
« Article 10. Reconnaissance en faveur des personnes décédées pour la défense de la démocratie pendant la période comprise entre le 1º janvier 1968 et le 6 octobre 1977.
Au regard des circonstances exceptionnelles concourant à leur décès, s´établit la reconnaissance du droit à une indemnisation, dont le montant s’élève à 135.000 € en faveur des bénéficiaires des personnes décédées pendant la période comprise entre le 1er janvier 1968 et le 6 octobre 1977, pour la défense et la revendication des libertés et des droits démocratiques. »
« Article 11. Collaboration des administrations publiques avec les particuliers en vue de la localisation et de l’identification des victimes.
Dans le cadre de leurs compétences, les administrations publiques faciliteront aux descendants directs des victimes le sollicitant ainsi, la mise en œuvre d’opérations de fouilles, de localisation et d’identification des personnes victimes de disparitions forcées pendant la guerre civile ou la répression politique qui s’ensuivit, et dont le lieu d’inhumation demeure inconnu. »
« Article 20. Création d’un Centre de documentation de la mémoire historique et des Archives générales de la guerre civile.
Le Centre de documentation de la mémoire historique mènera à bien les fonctions suivantes :
a) Conservation et développement des Archives générales de la guerre civile espagnole créées par le Décret royal 426/1999 du 12 mars. A cet effet, et en vertu de la procédure établie réglementairement, seront incorporés à ces Archives tout document original ou toute copie digne de foi desdits documents relatifs à la guerre civile de 1936-1939 et à la répression politique qui s’ensuivit […]. De même, l’Administration générale de l’État se chargera de la compilation d’importants témoignages oraux en rapport avec la période historique en question, en vue de leur dépôt et de leur intégration aux Archives générales.
b) Récupération, rassemblement, gestion et mise à disposition des personnes intéressées des fonds documentaires et des sources secondaires susceptibles de constituer un intérêt au regard de l’étude de la guerre civile, de la dictature franquiste, de la résistance des guérillas à son encontre, de l’exil, de l’internement des Espagnols dans des camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale et la transition.
c) Soutien à la recherche historique relative à la guerre civile, au franquisme, à l’exil, à la transition, et contribution à la diffusion des résultats en découlant. »
Telles sont les grandes lignes de ce projet de loi, connu dans les media comme étant celui de la mémoire historique. Or, le mot « mémoire » ne fait pas partie du très long titre officiel de ce projet : « Projet de loi de la reconnaissance et de l’extension des droits aux victimes de la guerre civile et de la dictature » [3] .
En choisissant cet intitulé, les socialistes au pouvoir ont fait preuve de prudence et de grande volonté de concorde, pleinement conscients de l’inquiétude que la notion de « mémoire historique » inspire toujours au sein de la société espagnole [4] . En effet, il s’agit d’une société héritière de l’oubli imposé autour des terribles maux nés de la période de la guerre civile et du franquisme, l’une des pires violences infligées aux Espagnols pendant leur XXe siècle. Cet oubli imposé fut, à son tour, associé à des pactes de silence implicites au sein d’une population en proie à la terreur, ainsi qu’au refoulement engendré par la panique elle-même. Pour parler à la manière de Thucydide, on dirait : phobos mnêmen ekplêttei, « la frayeur met la mémoire en déroute » [5] .
Néanmoins, la démonstration de prudence affichée par l’exécutif socialiste a été, d’une part, jugée excessive par les partis de gauche ; d’autre part, elle n’épargna pas non plus une réponse exaspérée (et exaspérante) du dirigeant du Partido Popular, — un parti réunissant l’ensemble des tendances de la droite dans l’arène politique espagnole de nos jours. Devant un groupe d’historiens réunis à l´occasion d’un colloque à l’Université Menéndez Pelayo, le chef de l’opposition réagit à l’annonce du projet de loi en évoquant la Constitution de 1978, un système qu’il définit d’emblée comme le pacte scellé par l’ensemble des forces politiques de l’État en vue de ne pas remémorer les maux du passé :
Réviser l’histoire c’est un mécompte grossier, inutile à tout point de vue. Les Espagnols veulent regarder vers le futur, en aucun cas parler de République et de franquisme [6] .
Voici le message, clairement mémoricide [7] , avec lequel la droite a choisi d’affronter (au nom d’une « Unité de l’Espagne » directement inspirée de la devise franquiste d’une « Espagne Une ») l’avènement de la loi de la Mémoire historique. Plus précisément, c’est le message choisi par l’héritier politique le plus direct − dans le nouveau contexte démocratique, bien entendu − du franquisme victorieux. Ce même régime qui ne ménagea ni les ressources d´ordre économique ni les ressources d´ordre spirituel pour com-mémorer à jamais les « soldats tombés pour Dieu et pour la Patrie », selon la formule officielle. Pendant plus de quatre décennies, les prouesses de ces « héros de la patrie » ont été louées et leurs noms immortalisés, ciselés sur des monuments dressés en leur honneur ou inscrits sur les murs sacrés des églises. Parallèlement, cette consécration de l’héroïsme accentuait l’annulation de la mémoire des victimes républicaines, ces victimes « rouges » dépourvues du droit d’être pleurées en public et, souvent, dépourvues même de sêma, vu le grand nombre de corps qui furent ensevelis dans des fosses communes, anonymes.
Malgré les injustices infligées par le Movimiento aux principes d’humanité les plus élémentaires, les étapes clés de la Transición democrática española, qui s’étendit de 1976 à 1983, ont été marquées par des amnisties : celle du 30 juillet 1976, élargie par celle du 14 octobre 1977. Et ces amnisties, collectives et unidimensionnelles [8] , ont fait honneur à leur étymologie en se posant comme forme d’“amnésie”, d’oubli même du fait que toute une génération avait déjà été contrainte d’oublier. Du reste, en n’octroyant implicitement la liberté et le pardon qu’aux pourchassés du franquisme, ces deux pactes d’ « enterrement », « d’enkystement » [9] , du conflit civil, ont collaboré efficacement à l’impunité des criminels du régime. Oubli donc du passé sans réparation morale pour les défenseurs de la démocratie en période dictatoriale, telle a été la voie menant vers la « réconciliation et la concorde », vers le « reencuentro » des Espagnols, une voie indiquée et même préconisée par les « Pères de la Constitution » sous la protection d’une monarchie qui s’est voulue, avant tout, unifiante [10] .
Par bonheur, l’activité débordante des historiens qui, à l’heure actuelle, s’efforcent de dévoiler les chiffres, les données et les faits concernant les périodes républicaines et franquistes, dément l’avis du porte-parole de la droite espagnole. D’ailleurs, on peut affirmer que dans les quatre dernières décennies, l’effort de reconstruction de la mémoire historique réalisé par des historiens, nationaux et étrangers, ainsi que par de nombreuses associations représentant les victimes des représailles [11] , contraste, de plus en plus, avec le laconisme tout à fait timoré du discours politique officiel. Pour tranquilliser ceux qui, s’identifiant comme partie intégrante de l’Espagne victorieuse de 1938, craignent un débat sur la mémoire historique, on rappellera que ce débat risque de ne pas gêner uniquement l’imaginaire politique du franquisme. Il peut également ébranler le halo héroïque enveloppant les victimes républicaines, tout spécialement dessiné par l’important mouvement anti-franquiste des années 1960 et 1970.
En choisissant, en l’occurrence, un exemple français, on évoquera l’essai écrit par Bartolomé Bennassar intitulé La guerre d’Espagne et ses lendemains. Cet essai, publié en 2004, s’ouvre par une affirmation catégorique :
« Après une période d’amnésie volontaire et presque totale, la guerre civile d’Espagne sollicite aujourd’hui la mémoire. »
Et Bennassar précise, un peu plus loin dans l’avant-propos :
« L’acharnement de la lutte peut expliquer les épisodes les plus sanglants, mais ne peut être invoqué pour rendre compte des exécutions capitales qui se produisirent plusieurs mois, voire dix ans ou davantage, après le défilé de la victoire. Il ne saurait être question pour autant d’oublier ou de minimiser les responsabilités des partisans de la République, notamment de l’extrême gauche, dans le déclenchement de la tragédie […] L’Histoire n’a que faire du « politiquement correct » [12] . »
Comme il se doit, l’historiographie la plus récente tente d´envisager le conflit en examinant l’ensemble des perspectives. Dans cette approche se glisse en toute simplicité — il faut bien le dire – la révision du passé qui érige une image de Franco en « bon tyran » [13] ; une image tout à fait dans la ligne du turanos de l’archaïsme grec. Cette relecture se fait de préférence en mettant en relief l´essor économique connu par l’Espagne à partir des années 1960. En même temps, ce discours révisionniste minimise d’autres aspects de la dictature, ainsi l’utilisation perverse qu’elle fait des institutions politiques et juridiques par le biais de leurs militarisations [14] .
Dans les grandes lignes, l’actuelle effervescence de l’activité des historiens permet de dresser un contre-feu efficace aux maigres thèses du discours révisionniste en explorant des aspects jusqu’à alors ignorés ou quasi ignorés, ou bien en approfondissant ceux qui avaient été déjà examinés. Ce faisant, la recherche historique prouve que non pas « tous les Espagnols », certes, mais que bon nombre d’entre eux, ne croient à la possibilité d’une solide réconciliation que si celle-ci est fondée sur le bon exercice de la mémoire historique, c’est-à-dire sur la compréhension du conflit. Un tel travail collectif s’inscrit dans un cadre où la pratique juridique devrait être indissociable de la pratique des historiens, malgré la méfiance des hommes politiques qui (comme celui que je viens de citer) se déclarent explicitement ennemis de la mémoire historique et refusent ouvertement de soumettre à l’avis des juges la question de la réparation des victimes de la guerre de 1936 et de la dictature triomphante.
Ce sont sans doute des manifestations modernes, apparues dès 1938, d’une dynamique de résistance à l’éclaircissement historique. On tâchera de soumettre ces manifestations à l’épreuve des observations – bien plus anciennes encore – des Grecs sur la stasis et du lien qu’elles entretiennent avec la mémoire, tout en tentant de mesurer la pertinence de l’anachronisme de ces observations. Dans ce dessein, on invoquera tout d’abord, vous l’avez deviné, l’écrit intitulé Éloge de l’anachronisme en histoire [15] , un écrit dans lequel Nicole Loraux conteste que l’anachronisme puisse être considéré comme la pire des erreurs pouvant être commise par l’historien.
En affirmant que « l’anachronisme s’impose dès lors que, pour un historien de l’Antiquité, le présent est le plus efficace des moteurs de la pulsion de comprendre » [16] , Nicole Loraux invite audacieusement à la – très controversée – « pratique contrôlée de l’anachronisme en histoire ». Et elle définit cet exercice historique au fil de l’invitation de Marc Bloch à « comprendre le présent par le passé et le passé par le présent » :
« C’est en renversant l’ordre dans lequel étaient énoncées ces deux opérations que, pour ma part, je réfléchirai sur la méthode qui consiste à aller vers le passé avec des questions du présent pour revenir vers le présent, lesté de ce que l’on a compris du passé. Encore convient-il de préciser – et c’est la dette que je me reconnais envers les travaux qui m’ont appris à faire de l’histoire – qu’il est dans la recherche une étape dont on ne saurait à aucun prix faire l’économie parce qu’elle constitue une condition nécessaire et un préalable au va-et-vient entre l’ancien et le nouveau. Je parle du moment où l’on tente de suspendre ses propres catégories pour cerner celles de ces « autres » que, par hypothèse, furent les anciens Grecs. Moment irremplaçable à coup sûr, et qui contribue à défaire l’illusion purement culturelle d’une familiarité. Mais, pour être nécessaire, la condition n’est pas suffisante et le travail ne s’achève pas avec la mise à distance.
C’est donc pour une pratique contrôlée de l’anachronisme que je plaiderai. »
Exercice intellectuel donc qu’est la « pratique contrôlée de l’anachronisme » qui requiert une grande maîtrise et « la plus grande mobilité », affirme Nicole Loraux, car : « Il faut savoir aller et venir, et toujours se déplacer pour procéder aux nécessaires distinctions » [17] . Tel est le bagage méthodologique avec lequel la prose, dense et acérée, de notre historienne conduit ses lecteurs vers l’un des noyaux de sa pensée : les discours à propos de la guerre civile, considérée comme un accident dans la vie de la polis, idéalement centrée dans la pratique politique et l’exercice de la guerre extérieure. De cette réflexion, pleine de nuances précieuses recueillies notamment dans les volumes La cité divisée et La tragédie d’Athènes, on évoquera seulement quelques jalons nous semblant particulièrement éloquents pour la lecture du cas espagnol.
Attentive à la portée de l’idéal de l’unité civique dans l’imaginaire athénien [18] , Nicole Loraux postule que le politique a été conçu sous le signe du consensus, de l’unité sans fissures de la famille métaphorique qu’est la polis elle-même. Une telle conception est indissociable de toute une série de stratégies, souterraines et précises, parmi lesquelles figurent deux opérations d’occultation capitales : celle qui consiste à ignorer les connotations politiques de la traumatisante stasis, et la seconde qui consistante à ignorer le fait que la guerre civile est un état possible de la cité. Deux dénis dans lesquels « l’instance pensante et désirante », qui pour un Grec serait la polis [19] , permet précisément de déceler l’importance du conflit en tant que lien « étrangement puissant » pour la communauté civique. C’est la conviction que Nicole Loraux érige en fil conducteur aussi bien de La cité divisée que de La tragédie d’Athènes.
« À rebours de la construction classique d’un paradigme de cité dont l’Un est le modèle, le scénario, à chaque fois, reviendra à mettre au jour, sous la belle construction, les linéaments d’une pensée que le discours officiel sur la communauté recouvre et peut-être refoule : sous l’excommunication de la stasis, la constatation redoutée que la guerre civile est connaturelle à la cité, voire fondatrice du politique en tant qu’il est précisément commun [20] . »
La spécificité de la dêmokratía se réexamine en ramenant le conflit au premier plan, un plan à la fois contigu et opposé à la définition du politique formulée par les Anciens. Ce travail est amorcé par Nicole Loraux avec l’analyse de l’amnistie proclamée à la fin du siècle d’or athénien, peu après la défaite d’Athènes (matérialisée par la destruction des Longs Murs) et une fois finie la déchirante guerre civile qui s’ensuivit. En 403 av. J.-C., les démocrates – les hommes du Pirée – abattent l’armée des Trente Tyrans, les chefs du gouvernement oligarchique qui avaient semé la terreur dans la cité divisée entre leurs victimes – assassinées ou dépossédées et exilées – et les citoyens ayant choisi de collaborer avec ces despotes. La haine suscitée par la violence des Trente semble annoncer une période de violence équivalente de la part des nouveaux vainqueurs. Cependant, les démocrates, en reconnaissant en leurs adversaires politiques des concitoyens plutôt que des ennemis, se sont réconciliés avec eux moyennant le serment solennel de « ne pas rappeler les maux », mê mnêsikakein, de « rejeter dans le non-être de l’oubli » les malheurs endurés.
Contrairement au principe vindicatif de « ne jamais oublier », les démocrates athéniens choisissent de ne demander des comptes qu’aux Trente eux-mêmes, quasiment les seuls rendus responsables du sang versé [21] . « Pour que vive la cité une », le Serment – fils d’Éris, la Discorde – s’impose comme « acte de langage » annulant cette « mémoire en acte » [22] , cette colère persistante désignée dans l’imaginaire grec comme féminine et anti-politique, qui empêche le travail thérapeutique de deuil.
L’oubli, donc, se pose en tant que règle du jeu démocratique. L’injonction de ne pas remémorer les maux infligés par le concitoyen-adversaire, s’affirme comme source de paix, mais aussi de trouble. Nicole Loraux repère les difficultés intrinsèques de cette réconciliation dans laquelle prétend s’enraciner la paix durable, en signalant la méfiance qu’inspire aux Anciens le plus ferme des critères de reconnaissance du régime démocratique : le fonctionnement des tribunaux de justice. Les institutions, vouées à juger avec équanimité les divergences entre des individus des deux factions, sont sur la sellette car susceptibles – par leur fonctionnement même – de raviver les affrontements qu’une fois bridés, la polis souhaitait, avant tout, oublier.
En considérant les affirmations des penseurs contemporains comme Thucydide qui inclut dans son récit de la guerre civile de Corcyre l’action juridique comme une des armes employées par les oligarques pour attaquer la démocratie [23] , Nicole Loraux constate :
« … à quel point l’entière cohérence [du procès athénien] suppose que dikê – la justice, mais aussi le procès – soit d’abord et avant tout une joute entre deux adversaires, devant un tribunal civique [24] . »
Cette définition du procès en tant que lutte fait écho chez notre historienne à l’amnistie de 403, pour y penser, cette fois, le danger de scission du dêmos que l’époque classique avait perçu dans le nom même de dêmokratia. Dans l’Athènes de 403 av. J.-C., la démocratie, sous la consigne de « ne pas rappeler », se met au service de la continuité de la polis et sacrifie à ce projet même « le contenu de son nom », ce nom qui renvoie au « pouvoir » du peuple avec les connotations de « victoire » implicites propres au terme de kratos. En effet, à ce moment-là, le mot dêmokratia évoque dangereusement le plus redoutable des succès : le fait qu’il y a eu division de la cité en deux parties et victoire de l’une sur l’autre [25] . Il en résulte que, si au Ve siècle, les démocrates « préfèrent se passer de donner un nom à leur régime », pendant la période démocratique du IVe siècle, polis devient le terme le plus important dans les textes athéniens de théorie politique et éclipse dêmokratia.
D’après Nicole Loraux, ce serait en ce moment et dans ce lieu précis qu’il faudrait situer l’origine du topos de la cité indivisible. Si Athènes matérialise le paradigme de Cité, de « cité idéale », ce ne fut pas grâce à son régime démocratique, mais grâce à la générosité avec laquelle celui-ci s’effaça au nom de la réunification. L’amnistie de la fin du Ve siècle, concernant, en apparence, le passé le plus récent, aurait atteint l’objectif plus global d’oublier institutionnellement que la division partagée préside l’origine même du politique : « que le politique est conflit » [26] .
Aristote, parmi d’autres penseurs de l’époque, esquisse l’image d’un système fondé sur l’oubli, lorsque, tout en opinant que les démocrates athéniens avaient utilisé leurs malheurs de la manière « la plus belle et politique » (kallista kai politikotata), il suggère que « la politique, c’est faire comme si de rien n’était. Comme si rien ne s’était produit. Ni le conflit, ni le meurtre, ni la rancune (ou la rancœur) » [27] . Or, la voix monarchique d’Aristote n’est pas la seule à faire l’éloge de l’usage démocrate du triomphe. Le caractère exemplaire et indiscutable de cette victoire est loué à l’unanimité par les Athéniens de toutes tendances politiques confondues. Un consensus que Nicole Loraux perçoit comme inquiétant et dont elle décrypte la finalité en proposant une hypothèse basée sur le principe suivant : ceux qui privilégient la version qui octroie au peuple une victoire absolue chercheraient, en fait, à « faire peser sur la politique du dêmos quelque chose comme le sentiment d’une écrasante responsabilité » : celle du devoir de clémence [28] .
Un déploiement de générosité de la part du vainqueur, plutôt qu’une vengeance répressive, tel fut le choix des démocrates athéniens pour mettre un point final à la guerre civile. Une option tout à fait différente se dégage de l’expérience vécue dans le camp des vaincus de l’après-guerre espagnole (avec un bilan d’approximativement 50.000 morts au titre des représailles [29] ), qui reflète néanmoins une nette ressemblance dans la détermination des démocrates au moment, très délicat du point de vue politique et émotionnel, de la mort de Franco. Je pense à la décision institutionnelle prise en 1978 de ne pas revenir sur les crimes de guerre afin que la scission civile ne se reproduise « nunca más ». « Plus jamais » fut, en effet, la consigne du lent changement de régime appelé Transición.
Par rapport à la victoire vindicative mise en scène par les Franquistes, la coïncidence entre le phénomène athénien et l’espagnol est si remarquable que l’on serait tenté de croire à l’existence d’une forme d’hidalguía trans-temporelle et tout à fait propre aux démocrates en position de vainqueurs dans une guerre civile. Néanmoins, les nuances de la réflexion déployée par Nicole Loraux à propos de la place de la mémoire dans cette affaire d’amnistie méritent bien que l’on s’y attarde.
Il convient, en effet, de discerner si le pacte visant à oublier a pour but l’effacement de la moindre trace d’une lutte à mort entre concitoyens ou bien si l’amnistie prétend plutôt habiliter un espace temporel afin que le travail de deuil puisse se réaliser efficacement. C’est à cette condition que peut se réaliser la thérapie que l’on reconnaîtra comme étant vitale pour les États comme pour les individus, compte tenu de l’analogie de la cité avec l’individu sous-jacent à l’invention, bien grecque, du politique [30] . Ce rapprochement nous conduit à rappeler qu’entre l’autrefois grec et l’Espagne contemporaine les correspondances ne sauraient être absolues.
Dans le cas espagnol, au moins deux conséquences indésirables auraient pu découler du type d’amnistie susceptible d’être identifiée (tout d’abord étymologiquement) à un décret d’amnésie collective. Cette amnésie, et je parle ici de la violence des relations avec les séparatistes basques, a amplifié celle que Franco avait imposée par un détour tout à fait opposé en agitant viscéralement le souvenir le plus sanglant de la tragédie vécue afin d’éviter le fonctionnement réparateur de la mémoire historique, afin d’occulter les faits historiques.
La première de ces conséquences implique que les conflits non assumés se déplacent symboliquement vers des paysages voisins, tout comme dans la tragédie athénienne – qui interdisait à titre officiel de mettre en scène les déroutes de l’Attique – où les crimes les plus horribles se déroulaient aux villes frontières d’Argos ou, plus souvent, de Thèbes [31] . En effet, l’Espagne, oublieuse – plus ou moins consciemment – du rôle d’ « anti-cité » qu’elle a joué dans les années soixante et soixante-dix sur la scène européenne – et, plus particulièrement, sur la scène parisienne – révèle, dans les derniers temps, une tendance très prononcée à ramener à son propre scénario politique des scissions civiles sanglantes liées aux pays latino-américains. Pays vis-à-vis desquels elle proclame la fraternité, tout en les sachant tenus à distance par un océan bien rassurant. L’Espagne s’érige ainsi en modèle de transition démocratique, tout en réalisant des actions pour le moins controversées. On pense à celles qui ont été entreprises par le Juge Garzon contre le Général Pinochet – jamais contre un militaire espagnol – à un moment pour le moins délicat du point de vue de la mémoire historique du peuple chilien [32] .
Une deuxième séquelle, à effet plus directement identifiable, aurait pu émaner de l’institution de l’oubli comme moyen de réconciliation civique. À savoir qu’à l’encontre de toute prévision, la mémoire d’une partie du peuple, si minoritaire soit-elle, réagisse violemment et refuse d’accepter la prescription des crimes de guerre. C’est alors l’avènement de la « mémoire colère » que les Grecs désignent comme mênis, « …figure féminine de la mémoire – dit Nicole Loraux – que les cités s’efforcent de cantonner dans la sphère de l’anti- (ou de l’anté-) politique » ; la forme de mémoire complice de l’alastos penthos, « ce deuil qui ne veut pas se faire » [33] , toujours susceptible de raviver une guerre civile.
En ce qui concerne cette deuxième conséquence, un commentaire formulé par Felipe González au sujet des « Commissions de la Vérité pour la réconciliation et la justice » nous semble particulièrement éloquent. Ces Commissions de recherche historique, à rebours de l’amnésique cas espagnol, ont été organisées au Chili et en Argentine en vue de découvrir les causes des conflits civils exacerbés ainsi que d’établir les responsabilités juridiques adéquates :
« Je pense — disait Mr. González en tant que conférencier invité — à la fracture civile de la société basque et à la problématique territoriale comme le seul fantasme du passé que nous n’avons pas pu surmonter pour nous reconnaître dans ce « nous » qui est le fondement de la coexistence en paix et en liberté [34] . »
La reconnaissance du terrorisme (« interne », il faut, malheureusement, bien le préciser à présent) en tant que prolongement de l’après-guerre civile est une réflexion assez insolite chez les représentants de deux grands partis politiques espagnols. Ceux-ci sont solidaires, en fin de compte, de la sempiternelle criminalisation entreprise par le système juridique des tentatives de dialogue avec les représentants politiques des terroristes.
Qu’ils soient populaires ou socialistes, les hommes politiques, sont le plus souvent tombés d´accord pour ne donner qu’une réponse policière et d’emprisonnement à l’encontre de la violence de l’ETA. Ils soumettent systématiquement les initiatives de dialogue au rythme, de plus en plus frénétique, du calendrier électoral [35] . Ils agissent, à n’en pas douter, tour à tour convaincus du fait que les urnes ne pardonneraient pas le parti au pouvoir de bien vouloir pactiser avec des malfaiteurs avant que ceux-ci ne rendent soudainement les armes. Une capitulation que les terroristes ne risquent pas d’octroyer dans l’immédiat.
Autrement dit, à l’heure actuelle, les deux groupes parlementaires majoritaires mettent en scène un débat houleux autour d’une Loi de la « Mémoire historique » — nécessaire, sans nul doute, bien que très tardive, compte tenu de la disparition de la plupart des individus ayant directement vécu le conflit. Entre temps, ces représentants politiques maintiennent sanglante (littéralement et électoralement sanglante) la vengeance terroriste qui ne cesse de rappeler sans relâche la non-réparation de l’agression première contre la patrie et la langue basque. C’est ainsi qu’un demi-siècle après la naissance de l’ETA, et malgré son net affaiblissement, nous sommes toujours bien loin de trouver (peut-être même de les chercher sincèrement) les clefs politiques et juridiques capables de la désarmer.
Entre-temps, les deux Espagne ont acquis la très redoutable habitude de ne fonctionner solidairement que dans l’affrontement viscéral face à cette organisation terroriste bien enracinée – maladivement encapsulée – au double carrefour de la droite et de la gauche, du constitucionalismo d’une part et du nacionalismo d’autre part. En définitive, l’Espagne démocrate, héritière du différend qui la structure, ne se révèle Une qu’en se servant du mécanisme pervers d’un conflit civil initial sans cesse ravivé. L’Espagne démocrate ne se révèle pleinement Une, que sous la forte attache consolidée (Nicole nous l’a bien appris) par « le lien de la division ». Écoutons-le encore une fois:
«Sans doute connaissons-nous des situations où il n’existe pas de solution qui puisse tout uniment être bonne ou mauvaise. Et, pour tenter de mettre en place les conditions de possibilité d’une négociation, il faut parfois commencer par oublier. Ou, du moins, par faire en tout comme s’il en était ainsi. Sans oubli, nul individu et nulle société n’échapperaient au régime de l’insomnie. Et cependant, nous n’avons pas fini de lutter contre les politiques de l’oubli [36] .»
Bibliographie
Aguilar, P. 1996. Memoria y olvido de la Guerra Civil española. Madrid.
Barrera, E. S. et Macías Pérez, S. M. 2003. Las fosas de Franco. Los republicanos que el dictador dejó en las cunetas. Madrid.
Bennassar, B. 2004. La Guerre d’Espagne et ses lendemains. Paris.
Bermejo, J. C. 2007. «La Pornografía de la memoria y la retórica de la muerte». In Moscas en una botella. Madrid : 87-108.
Casanova, J., ed. 2002. Morir, matar, sobrevivir: la violencia en la dictadura de Franco. Barcelona.
Cassin, B., Cayla, O. et Salazar, Ph.-J. 2004. Vérité, Réconciliation, Réparation. Le genre humain 43. Paris.
Darbo-Peschanski, C. 2005. Compte-rendu de Nicole Loraux, La tragédie d’Athènes. La politique entre l’ombre et l’utopie. Diogène 212 : 191-197.
Iriarte, A. 1999. « Los peligros del olvido como estrategia política ». Claves de razón práctica 93 : 73-75.
Iriarte, I. et Serra, J. 2005. Franco. El centinela de Occidente. Barcelona : Sagrera TV.
Loraux, N. 1997. La Cité divisée. L’oubli dans la mémoire d’Athènes. Paris.
2005. La Tragédie d’Athènes. La politique entre l’ombre et l’utopie. Paris.
1988. «Pour quel consensus?». Avant propos à «Politiques de l’oubli». Le genre humain 18 : 9-23.
Moa, P. 2003. Los mitos de la guerra civil. Madrid.
Payne, S. et Tusell, J. eds. 1996. La Guerra Civil: una nueva visión del conflicto que dividió España. Madrid.
Papadopoulou, I. 2003. «Nicole Loraux : de l’humanisme à l’âme de la cité». Kernos 16 : 9-16.
Portella, J. R. 1999. La Guerra Civil: ¿dos o tres Españas?. Barcelona.
Preston, P. 1998. Franco. Barcelona.
Rodrigo, J. 2005. Campos de concentración en la España franquista 1936-1947. Barcelona.
Vinyes, R. 2002. Irredentas. Las presas políticas y sus hijos en las cárceles franquistas. Madrid.
Footnotes
[ back ] 1. Loraux 2005 : 184.
[ back ] 2. Loraux 1997 : 25-26. Au sujet de l’oubli, se reporter aussi au volume collectif Politiques de l’oubli , publié dans la revue Le genre humain en automne 1988 avec pour chapitre introductif, rédigé par Nicole Loraux, « Pour quel consensus? ».
[ back ] 3. Loi 52/2007 (BOE n. 310 du 27/12/2007). Le texte intégral de la loi est publié sous format électronique sur le site Internet www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.
[ back ] 4. En ce qui concerne la décision de célébrer l’« Año de la Memoria » en 2006, envisagée à partir de la perspective de l’exploitation politique de la mémoire, voir Bermejo 2007 : 87-107.
[ back ] 5. Thucydide II, 87, 4.
[ back ] 6. El Correo, 29 juillet 2006 : 24 ; la citation que je traduis ici a, bien entendu, été reprise par l’ensemble des journaux nationaux ce jour-là.
[ back ] 7. Le terme de mémoricide est emprunté au vocabulaire politique du second XXème siècle. Il est souvent utilisé au sens de “purification culturelle” et désigne le refus d’expression d’une culture minoritaire.
[ back ] 8. Les implications de l’amnistie exemplaire consentie individuellement par la Commission Vérité et Réconciliation (CVR) dans le cadre de l’expérience sud-africaine de rupture avec l’apartheid, ont été soigneusement examinées dans le volume dirigé par Barbara Cassin, Olivier Cayla et Philippe-Joseph Salazar 2004 : 266-269 notamment.
[ back ] 9. L’apparition répétitive de ces notions dans les discours politiques de l’époque se perçoit bien dans l’étude consacrée à ces lois d’amnistie : Aguilar 1996 : 266-269.
[ back ] 10. L’historiographie contemporaine vouée à souligner le rôle totalisateur, au sens d’intégrateur, de Juan Carlos I pendant la Transición, est abondante. Elle renvoie inévitablement au paradigme athénien du politicien érigé entre deux factions : Solon, le « loup isonomique », l’homme de l’« impossible » position médiane, dont la complexité est soigneusement dévoilée par Loraux 2005 : 152 sqq.
[ back ] 11. Entre autres, La Asociación para la recuperación de la memoria histórica, la Coordinadora para la memoria histórica y democrática de Cataluña et El Foro de la memoria ou la Asociación guerra y exilio.
[ back ] 12. Bennassar 2004 : 7 et 9-10. Dans cette perspective : Portella 1999 ; se reporter tout particulièrement aux mots de l’éditeur page 22.
[ back ] 13. Moa 2003.
[ back ] 14. Pour ces autres aspects de la figure du dictateur, voir, par exemple, Preston 1998 ou – sous forme d’aigu documentaire – Iriarte et Serra 2005.
[ back ] 15. Article placé en position finale dans Loraux 2005 : 173-190, mais publié à l´origine dans Le genre humain 27 (1993) : 23-39.
[ back ] 16. Loraux 2005 : 175.
[ back ] 17. Loraux 2005 : 184.
[ back ] 18. Nicole Loraux l’avait déjà souligné dans sa thèse — L’invention d’Athènes. Histoire de l’oraison funèbre dans la « cité classique » (Paris, 1981) — et le soulignera encore dans Tragédie d’Athènes (2005), notamment dans le chapitre consacré à la guerre civile de Corcyre (pp. 31-60). En revanche, pour analyser la tendance à réduire la « sédition civile » à deux moitiés entre lesquelles il faut choisir sans nuances, se reporter à « La cité grecque pense l’un et le deux » in Loraux 2005 : 125-144.
[ back ] 19. Darbo-Peschanski 2005 : 193 synthétise nettement la problématique, centrale chez Nicole Loraux, consistant « à penser la cité comme un sujet, dès lors qu’on pose l’autonomie du politique grec, en choisissant d’en faire la résultante d’un ensemble d’opérations de pensée et de solutions imaginaires où interviennent le déni, le refoulement et l’oubli, plus volontiers que la conscience ». À ce sujet voir aussi .Papadopoulou 2003
[ back ] 20. Loraux 1997 : 95. Et dans Loraux 2005 : 141-160 (« Solon au milieu de la lice »).
[ back ] 21. Loraux 1997 : 154-155.
[ back ] 22. Loraux 1997 : 145 et 146 sqq.
[ back ] 23. Thucydide III, 70.
[ back ] 24. Loraux 1997 : 147.
[ back ] 25. Loraux 1997 : 66 sqq. et 265 sqq. Cette analyse révélatrice du terme dêmokratia est reprise dans Loraux 2005 : 185 « Dêmokratia, ou le pouvoir du dêmos, traduit-on souvent, et l’on ne s’attache alors qu’au premier terme de ce mot composé, à dêmos dont les historiens de l’Antiquité se plaisent à souligner à quel point sa signification est ambiguë, puisqu’il dénote aussi bien le peuple conçu comme un tout que la fraction politisée du peuple — entendons le « parti » démocratique, présumé correspondre à la majorité du peuple ».
[ back ] 26. Loraux 1997 : 254 et 255 sqq.
[ back ] 27. Loraux 1997 : 155.
[ back ] 28. Loraux 1997 : 261.
[ back ] 29. C’est le chiffre approximatif proposé dans le livre de Payne et Tusell 1996 : 602 sqq. Pour mesurer l’ampleur du désastre, se reporter aussi aux travaux récents de Casanova 2002 ; Vinyes 2002 ; Barrera et Macías Pérez 2003 ou Rodrigo 2005.
[ back ] 30. Dans les termes de Loraux 1997 :75 « …plus que toute autre chose [les Grecs], sous la rubrique du politique, ont pensé l’analogie de la cité avec l’individu ». Cf. Loraux 1997 : 49, et se reporter à notre note 17.
[ back ] 31. Loraux 1997 : 148 sqq.
[ back ] 32. Iriarte 1999.
[ back ] 33. Loraux 1997 : 163 sqq.
[ back ] 34. El País, 22 avril 2001 : 14.
[ back ] 35. Etant donnée la très courte durée qui caractérise ces initiatives, comme on a pu le constater encore récemment – grâce, sans doute, à une inusuelle transparence politique – à propos du « Proceso de Paz » précipitamment mis en marche et bloqué entre la deuxième et la troisième année de la législature 2004-2008 du PSE.