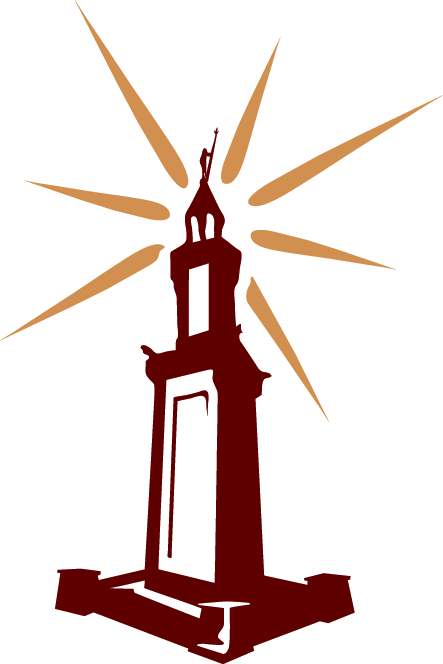Dans le parcours de Nicole Loraux à travers le féminin, l’homme grec et la démocratie athénienne, la figure de la mère, des mères, traverse tout le long de son œuvre. L’historienne étudie notamment comment les Grecs, en rêvant d’une filiation purement paternelle, cherchaient à neutraliser le rôle des femmes et spécialement celui de la mère pour mieux renforcer le pouvoir du père [1] . Cette figure de la mère est particulièrement mise en évidence dans deux ouvrages, Les Mères en deuil (1990) et Né de la Terre (1996). Dans le premier, Nicole Loraux a cherché à comprendre ce qui « dans le champ grec, fait du deuil des mères un enjeu pour la politique telle que la vie en cité la définit » [2] et pourquoi la cité n’a cessé de vouloir se protéger des débordements incontrôlés du pathos féminin durant le deuil, en imposant des limites à l’expression de leur mênis. C’est dans la tragédie, où sont exacerbés les tensions entre les sexes, que Nicole Loraux débusque ces « mères en deuil » et ces mères meurtrières qui ne cessent de crier leur souffrance d’être mères et surtout mères de fils. Si, aux yeux des hommes grecs, la maternité permet aux femmes d’accomplir leur féminité, paradoxalement, c’est en tant que mères et plus précisément mères d’un fils qu’elles représentent un danger pour la cité [3] . C’est en effet parce qu’elles mettent au monde des fils qui partent en guerre pour défendre leur patrie et qui, souvent meurent au combat, que les mères participent au politique et pourraient alors revendiquer un rôle civique. Face à un tel danger, nous dit Nicole Loraux, « l’idéal serait d’enfermer hermétiquement la douleur féminine à l’intérieur de la maison, surtout lorsque la femme endeuillée est une mère qui pleure son fils » [4] .
Dans Né de la Terre, poursuivant ses recherches sur l’imaginaire grec et l’identité politique entamée lors de sa thèse publiée en 1981 sous le titre L’invention d’Athènes [5] , l’historienne revient sur le mythe de l’autochtonie athénienne pour proposer une lecture des fictions grecques sur l’origine des hommes qui légitiment l’exclusion des femmes et du féminin. En lectrice avisée de Platon, elle consacre plusieurs chapitres aux récits platoniciens sur l’autochtonie [6] et tente de restituer à son auteur une formule devenu célèbre, « ce n’est pas la terre qui imite la femme, mais la femme, la terre », et au lieu de la réduire à un énoncé, elle insiste pour la lire dans son ensemble et dans le mouvement même de son argumentation [7] . Dans son chapitre « Pourquoi les mères grecques imitent, à ce qu’on dit, la terre », consacré à une analyse lumineuse du développement du Ménexène d’où est extrait l’énoncé platonicien, Loraux observe que « la terre est l’Une, seule mère incontestable, tandis que pris dans un processus d’imitation, le féminin s’est à jamais doublé du multiple, et, s’agissant des génitrices humaines, on dit : “les mères” » [8] . C’est cette question de la mère singulière et des mères multiples dans la pensée de Platon que je propose de regarder aujourd’hui à travers, encore une fois, l’autochtonie développée par Aspasie dans le Ménexène mais aussi la structure de la famille et la place des mères dans la communauté des gardiens dans la République.
Dès le préambule du Ménexène, Platon donne le ton du dialogue. S’adressant à Ménexène, Socrate évoque de façon on ne peut plus ironique la simplicité et la banalité du discours convenu de l’oraison funèbre à la gloire de la grandeur d’Athènes et de son armée, exaltant les morts et les vivants quels qu’ils soient. Ce discours préparé longtemps à l’avance, qui n’est qu’un défilé de lieux communs, pourrait être composé par le premier venu, à commencer par Socrate lui-même qui a pour maître (ê didaskalos) d’éloquence [9] Aspasie, l’auteur de l’oraison funèbre prononcée par Périclès. C’est ce discours, composé par une femme, ce qui en redouble la dimension critique, que Socrate se propose, comme une plaisanterie, de rapporter à Ménexène [10] .
Respectant l’ordre habituel, Aspasie commence son oraison funèbre par le thème traditionnel de l’autochtonie des Athéniens. Mais là où d’autres, à commencer par Périclès [11] , se contentent d’évoquer l’autochtonie des Athéniens, Aspasie s’attarde à exalter cette Terre-Mère originelle au détriment, nous rappelle Loraux, de la fonction génitrice de la femme puisque, selon l’oratrice, « ce n’est pas la terre qui a imité la femme dans la conception et la génération, mais la femme la terre ». Nous allons voir qu’avec Platon les choses ne sont jamais aussi simples qu’elles ne paraissent et que « chaque énoncé, poussé trop loin, jusqu’au bout de sa logique, se détruit lui-même » [12] . Je propose alors de regarder, une fois de plus, ce passage où Platon cherche à prouver l’antériorité de la Terre sur les femmes dans le processus de la génération des hommes. Pour y parvenir, il a recours à un raisonnement particulièrement tortueux qu’il serait trop simple de réduire, comme le fait R. Clavaud, au syllogisme : « tout ce qui enfante nourrit, or l’Attique a dès l’origine porté le blé, donc elle a enfanté l’homme » [13] .
J’emprunte à Nicole Loraux sa traduction :
Or, il y a un grand indice en faveur de cet argument que c’est elle, notre terre, qui a enfanté (tiktein) les ancêtres de ces morts et les nôtres. C’est que tout ce qui enfante possède une nourriture appropriée à ce qu’il enfante, par là où une femme aussi donne à voir qu’elle a enfanté véritablement ou non (elle suppose un enfant lorsqu’elle ne possède pas de sources de nourriture pour sa progéniture). Voilà précisément ce que notre terre aussi, qui est en même temps notre mère, fournit comme suffisant indice de ce qu’elle a engendré des hommes : c’est que, seule en ce temps d’alors et la première, elle a porté pour l’homme le fruit du blé et de l’orge, nourriture la plus belle et la meilleure pour le genre humain, car elle a réellement engendré elle-même cet animal. Or c’est plus au sujet de la terre qu’il convient d’accepter de tels indices : car ce n’est pas la terre qui a imité la femme dans la conception et l’enfantement, mais la femme qui a imité la terre [14] .
Ainsi, prétend Aspasie, c’est la terre et non la femme qui est la mère originelle de tous les hommes. Cette rivalité entre la terre et la femme dans le processus de la génération des hommes ne semble pas aller de soi puisqu’il est nécessaire d’en apporter la preuve (tekmêrion). Aspasie part du postulat que ce qui permet de déterminer la véritable maternité est la nourriture que possède tout être qui a enfanté. Postulat dont on va trouver la preuve dans l’exemple concret de la maternité de la femme : on distingue en effet une femme qui a réellement enfanté de celle qui simule un enfantement parce qu’elle a du lait pour nourrir son enfant. La preuve étant donnée, on passe ensuite, comme si de rien n’était, à la preuve par l’exemple de la terre : « la terre elle aussi donne la preuve qu’elle a engendré des hommes puisqu’elle porte en elle la nourriture la mieux adaptée à l’homme, le fruit du blé et de l’orge » [15] .
Le raisonnement d’Aspasie qui part d’une notion abstraite qui généralise et surtout désexualise l’enfantement, « tout ce qui enfante (pan to tekon) », légitime certes la puissance maternelle de la terre mais ne permet en aucune façon de démontrer l’antériorité de la terre sur la femme dans le processus de la génération des hommes. Je serais même tentée d’inverser la proposition d’Aspasie puisque la nourriture produite par la terre, le blé (puros) et l’orge (krithê) sont par excellence des plantes cultivées et travaillées par les hommes. Le blé, rappelle J.-P. Vernant, est de tous les fruits de la terre le plus humanisé et ne se récolte que cultivé au terme d’une année de soins attentifs comparable à l’éducation qu’on donne aux enfants pour en faire des hommes [16] . Cette nourriture, censée démontrer la puissance maternelle de la terre, suppose donc déjà la présence des hommes et donc des femmes. Par un coup de force rhétorique, Platon pose la terre comme paradigme du processus de la génération alors même que ce qui lui permet d’appréhender ce processus et d’en prouver l’authenticité a été le paradigme de la femme qui enfante. Pur raisonnement sophistique que celui d’Aspasie qui retourne l’énoncé contre lui-même et que l’on pourrait gloser, de façon tout aussi sophistique par « le modèle, la terre, imite la copie, la femme ».
A défaut de démonstration, les auditeurs doivent se contenter d’une affirmation : « la terre seule et la première », celle-ci étant aussitôt relayée par une allégation qui introduit la femme « c’est plus au sujet de la terre que de la femme qu’il convient d’accepter de pareils indices ». C’est ainsi que la femme, dont il n’est jamais dit qu’elle est mère, − à son propos Platon écrit « la femme qui enfante (gunê tekousa) » − est évincée du processus originaire de la génération des hommes. Mais la femme n’est pas la seule à être évincée dans le discours d’Aspasie. La mise en avant du rôle maternel de la terre se fait également au détriment du père. La terre-mère porte et engendre seule, sans père, ce qui, nous rappelle V. Sebillotte Cuchet est particulièrement rare [17] . Sans femme comme rivale, sans père comme géniteur, la terre devient alors la mère toute puissante des Athéniens. Cette survalorisation de la terre mère, y compris dans son autonomie reproductrice, peut sans doute se comprendre, nous dit V. Sebillotte Cuchet, comme un effet de dérision par rapport au tout paternel de l’oraison funèbre rapportée par Thucydide [18] . On peut aussi comprendre le règne de la mère sur la terre athénienne comme une défiance de Platon envers sa patrie. Le discours du Ménexène est, on l’a dit, un discours parodique et ironique de ce logos politikos qu’est l’oraison funèbre. Platon donne parole à Aspasie pour mieux s’en prendre à Périclès et la démocratie athénienne, qui, selon lui, « dispense identiquement une sorte d’égalité aux égaux et aux inégaux » [19] . L’aspect satirique de ce logos politikos, par essence viril, est renforcé par le fait qu’il est composé par une femme, même si parfois, Platon joue à semer le trouble en utilisant le masculin quand le locuteur, Aspasie, se désigne lui-même [20] . Ce jeu étrange du Ménexène, où les approximations succèdent aux anachronismes [21] , permet, entre autres, au philosophe d’introduire dans un récit sur l’autochtonie des anthropoi, c’est-à-dire du féminin, là où il ne devrait jamais y en avoir [22] . Il faut croire que lorsqu’une femme parle de l’autochtonie, elle ne peut totalement effacer la présence des femmes. Cette présence féminine dénature la structure même du mythe puisque, pour reprendre les termes de Loraux [23] , Aspasie subvertit le discours ordinaire de l’autochtonie, qui ne connaît que des mâles (andres), comme enfants de la terre attique [24] , pour lui substituer un mythe d’origine des anthropoi [25] : Au temps lointain où la terre entière produisait et faisait croître des animaux de toutes sortes, bêtes fauves et troupeaux, en ce temps là la nôtre se révéla non génitrice et pure de bêtes fauves sauvages (sic) mais, à son propre usage parmi les animaux elle (la terre) choisit et engendra l’homme (anthropon), qui, par l’intelligence, dépasse les autres et seul croit à la justice et aux dieux [26] . Ce déplacement de la rhétorique de l’autochtonie athénienne vers un mythe d’origine de l’humanité toute entière, dépolitise le propos de l’oraison funèbre. Ainsi, minée par la présence des femmes et du féminin, dénaturée par l’absence des andres, l’oraison funèbre d’Aspasie est insidieusement vidée de son sens et donc de son impact supposé sur ses auditeurs. Ajoutons par ailleurs qu’Aspasie est étrangère, comme s’il fallait redoubler le discrédit d’une parole féminine par “l’ étrangèreté” de sa locutrice.
La Terre est donc, affirme Aspasie, l’Unique mère des Athéniens. Commune à tous, elle fonde l’égalité politique par une égalité d’origine : « Tous frères, nés d’une même mère » [27] . Mais comme on a pu le voir, le modèle humain des femmes qui enfantent, et donc des mères au pluriel, n’est jamais très loin, ne serait-ce que dans la dénégation, ne serait-ce que pour permettre au raisonnement de se soutenir.
Les mères plurielles de la République sont-elles encore des mères ?
Si, on l’a vu, la Terre, mère unique, laisse place dans le Ménexène à une reconnaissance en creux du rôle de la femme humaine et donc des mères au pluriel, c’est surtout dans la République et les Lois que, constate Loraux, le pluriel associé aux mères prend toute sa dimension : Il faudrait alors préciser tout ce qui sépare la mère, différente, indifférenciée et échappant à toute prise, de ce que dans les développements programmatique de la République ou des Lois, désigne le pluriel « les mères ». Car les mères, ce sont les mères humaines dans leur multiplicité, génitrices désappropriées de leur progéniture mais à jamais libérées du souci du propre et à qui, la cité en sa bienveillance fonctionnelle a donné une génération entière à nourrir et à bercer. Celles-là sont les mères [28] .
Il est indéniable que dans les Lois, cité humaine et non divine [29] , Platon valorise la maternité et le rôle des mères pour en faire une fonction absolument indispensable à la bonne marche de la cité. Ces dernières élèvent les jeunes enfants, enseignent aux plus âgés, participent aux tribunaux de la famille et y ont un droit de vote, exercent la charge « d’inspectrices des mariages » et participent à la défense militaire de la cité [30] . Dans cette cité humaine des Lois, les mères ne se contentent pas d’œuvrer à sa reproduction, même si elles doivent obligatoirement être mère d’au moins deux enfants, un garçon et une fille. Elles sont mères vis-à-vis de leurs enfants, mères vis-à-vis des dirigeants et de l’ensemble du système social. Ce sont des mères plurielles aux fonctions plurielles.
Dans la République, le rôle des mères est, me semble-t-il, plus complexe.
Profondément marqué par les circonstances de la mort de son maître, Platon construit une cité en réaction contre la corruption, la démagogie et la perversion des institutions, toutes choses qui, selon lui, gangrènent la cité athénienne. Il propose alors de créer une cité « juste » − c’est le thème du dialogue −, « Une » et indivisible, fondée sur l’amour de la science et de la vérité, assurant à l’ordre politique l’harmonie, l’équilibre, la concorde, nécessaires à un mode de vie vertueux. La réalisation de la cité idéale est précédée par la description d’une cité corrompue, une cité de « pourceaux », encore dépourvue d’une véritable organisation politique, une anti-cité idéale. Les mères de cette cité sont sans aucun doute des mères humaines et plurielles (livre II). Livrées à elles-mêmes, ce sont de mauvaises éducatrices, qui donnent à leurs enfants une vision totalement immorale des dieux [31] en leur racontant des « contes de bonnes femmes », inspirées des poèmes d’Hésiode et d’Homère.
Lorsque Platon expose la construction de la cité idéale et le mode d’organisation des gardiens, la fonction maternelle change radicalement :
Ces femmes de nos gardiens seront communes toutes à tous ; aucune n’habitera en particulier avec aucun d’eux ; les enfants aussi seront communs, et le père ne connaîtra pas son fils, ni le fils son père (…) Quant aux enfants, à mesure qu’ils naîtront, ils seront remis à un comité constitué pour eux, qui sera composé d’hommes ou de femmes ou des deux sexes, puisque les fonctions publiques sont communes aux hommes et aux femmes. Ils conduiront les mères au bercail, quand leur sein sera gonflé, employant toute leur adresse à ce qu’aucune ne reconnaisse son enfant ; si les mères ne peuvent allaiter, ils amèneront d’autres femmes ayant du lait ; et même pour celles qui le peuvent, ils auront soin que l’allaitement ne dure que le temps voulu (…) Quand les femmes et les hommes auront passé l’âge de donner des enfants à la cité, nous laisserons, je pense aux hommes, la liberté de s’accoupler à qui ils voudront, hormis leur filles, leur mère (…); Nous donnerons la même liberté aux femmes (V 461c). Du jour où un guerrier se sera uni à une femme, il traitera les enfants qui naîtront et au dixième et au septième mois après, les mâles, de fils, les femelles, de filles (V 457d-V 461d) [32] .
Une politique eugéniste
S’inspirant du modèle spartiate, Platon cherche à créer une communauté homogène et harmonieuse fondée sur une politique eugéniste implacable ; il s’agit de sauvegarder et d’améliorer ce qu’il désigne comme « la race » des gardiens. Cette politique eugéniste à pour immédiate conséquence une surveillance resserrée de la sexualité des gardiens par les plus hautes instances dirigeantes de la cité, les magistrats. Ces derniers autoriseront ou interdiront les accouplements entre gardiens selon la « qualité » des partenaires et organiseront eux-mêmes des rencontres amoureuses entre les individus les plus conformes à l’image du gardien parfait. Ils devront procéder, nous dit Platon, de la même façon qu’un éleveur cherchant à améliorer la race de ses animaux et donc faire en sorte, au moyen de mensonges et de frauduleux tirages au sort, que les meilleurs éléments se rencontrent le plus fréquemment possible, et les moins bons le plus rarement (République V 459b) [33] . Ce contrôle de la vie sexuelle des gardiens condamne toute union privilégiée entre un homme et une femme et il est formellement stipulé qu’aucune femme ne devra vivre avec aucun homme (V 457d). Or, la vie commune, on le sait, était en Grèce, l’une des principales conditions de la légitimité du mariage. Mais la cité idéale ne supprime pas pour autant la notion d’union légitime, elle en change simplement les règles. Pour être légitime et acceptée par les magistrats, l’union d’un homme et d’une femme doit donner lieu à des cérémonies spécifiques et observer certains rites sociaux et religieux dont le seul objectif est, nous dit Platon, de « conserver pure la race des gardiens » (V 460a). Dans cette perspective, les hommes et les femmes sont probablement appelés à se « marier » plusieurs fois, avec des partenaires différents. Le mariage est limité au temps de la rencontre amoureuse et il peut se répéter autant de fois qu’il est nécessaire à la reproduction eugénique. Les gardiens devront cependant respecter l’âge légal pendant lequel ils sont autorisés à avoir des enfants, soit de vingt à trente ans pour les femmes [34] , et de trente à cinquante ans pour les hommes. Les enfants nés en dehors des règles juridiques et religieuses, de même que les enfants difformes ou issus de citoyens de qualité inférieure (V 460c) sont considérés comme des bâtards (V 461b) et rejetés par la cité. Alors qu’à Athènes il semblerait que les bâtards puissent, sous certaines conditions, être reconnus comme citoyens à part entière [35] , Platon leur refuse le droit de cité, et même, probablement, le droit à l’existence. En dehors des périodes réservées à la procréation, les gardiens, hommes et femmes, bénéficient d’une liberté sexuelle sans restriction autre que celle de l’union incestueuse [36] .
Une maternité instrumentalisée
Dès la naissance, les enfants sont séparés de leur mère, conduits dans un enclos, un lieu retiré de la cité qui leur est spécialement alloué. Les nourrissons sont alors confiés à un comité composé d’hommes et de femmes et entièrement pris en charge par le comité. L’enfant ne connaîtra jamais la femme qui l’a mis au monde et la mère ne pourra jamais identifier un enfant comme étant celui qu’elle a enfanté. Cependant, chacune des femmes ayant eu un enfant est automatiquement désignée comme l’une des mères des enfants du groupe. Ainsi, la fonction symbolique de mère est préservée mais elle n’a plus aucun lien avec la procréation et la mise au monde d’un enfant en particulier. Le rôle de mère se borne alors aux strictes fonctions biologiques qui caractérisent le sexe féminin, l’accouchement et l’allaitement. Peu importe d’ailleurs quelle femme allaite quel enfant ; « Si les mères ne peuvent allaiter, ils amèneront d’autres femmes ayant du lait ; et même pour celles qui le peuvent, ils auront soin que l’allaitement ne dure que le temps voulu » (République V 460c-d). Les hommes quant à eux, ne sauront jamais s’ils ont réellement engendré un enfant. En revanche, ils sont assurés − symboliquement − d’une puissance reproductrice sans faille et sans autre limite que celle de l’âge puisqu’à partir du jour où un homme gardien s’unit à une femme, il est virtuellement le père d’un des enfants du groupe [37] .
La maternité et la procréation des enfants sont ainsi instrumentalisés au profit du groupe, ce qui prive les femmes gardiennes du pouvoir que les femmes grecques ont, selon Aristote [38] , de désigner un homme comme le père de l’enfant, et de déterminer la véritable paternité. Mais cette dépossession intervient dans un contexte où les femmes de la communauté des gardiens sont strictement égales aux hommes et partagent avec eux les fonctions politiques et militaires de la cité. Égaux en politique, égaux sur le plan de la génération, il n’est pas nécessaire d’affirmer sa différence sexuelle pour délimiter les rôles et les pouvoirs réciproques de chacun des sexes.
La famille généralisée à l’ensemble de la communauté
On a souvent dit que Platon, dans la République, avait voulu supprimer la famille [39] . Ce n’est pas tout à fait exact. La communauté des gardiens dissout les liens privés qui habituellement unissent les membres issus d’une même souche biologique, mais il reconstitue, du moins symboliquement, une famille généralisée au sein de la communauté des gardiens. Aux fonctions symboliques de « père » et de « mère » correspondent les fonctions symboliques de « fils » et de « fille ». Les enfants appelleront tous les hommes et toutes les femmes en âge de les avoir engendrés du nom de « père » et de « mère ». La génération suivante regardera ces hommes et ces femmes comme leur « grand-père » et leur « grand-mère ». Enfin, les individus d’une même génération se nommeront entre eux « frères » et « sœurs ». Pour prévenir le risque d’union incestueuse et donc la confusion des places entre générations, les magistrats instituent une loi qui interdit toutes relations sexuelles entre générations différentes. Les hommes et les femmes ne pourront avoir de relations sexuelles qu’à l’intérieur d’une même génération, autrement dit, entre les supposés « frères » et « sœurs », et si le tirage au sort le décide et si la Pythie le confirme (V 461e) [40] .
Les liens de filiation consanguins sont ainsi remplacés par des liens de filiation par classe d’âge correspondant à une génération. Ils reconstituent fictivement le système de nomenclature de la parenté restreinte : enfants, parents et grands-parents. Toute femme est virtuellement la « vraie » mère, la « vraie » sœur ou la « vraie » fille d’un membre de la communauté. De même tout homme est virtuellement le « vrai » père, le « vrai » frère ou le « vrai » fils d’un membre de la communauté. Face à cette éventualité toujours présente, chacun est amené à considérer l’autre comme s’il était réellement un membre de sa famille et devra se comporter dans la cité en y transposant les valeurs de la famille. Le philosophe supprime le mode de classification des affins : oncle/tante, cousin/cousine, neveu/nièce, mais les rapports réels entre parents et enfants ainsi qu’entre germains ne sont pas désavoués par la cité mais seulement dissimulés pour mieux être exploités [41] . Dans la cité idéale, Platon cherche, me semble-t-il, à calquer l’organisation de la cité toute entière sur le modèle de la famille restreinte. Pour y parvenir, il supprime les liens personnels qui unissent habituellement les membres d’une famille biologique et particulièrement la relation privilégiée d’une mère avec l’enfant qu’elle a mis au monde, et les remplace par des liens collectifs et indifférenciés. Cette dépossession des femmes du lien entre maternité biologique et maternité sociale, du pouvoir spécifique qu’elles ont de mettre au monde les fils de la cité, est sans aucun doute le prix qu’elles payent pour être l’égale des hommes et accéder aux fonctions politiques et militaires. La différence des sexes n’est pas tout à fait niée, puisqu’elle joue un rôle fondamental dans la reproduction, mais ses effets d’opérateur de division entre deux modèles sociaux distincts sont neutralisés. Hommes et femmes sont unis dans une communauté où chacun et chacune participent de l’autre : Chez nous plus que partout ailleurs, les citoyens participeront au même intérêt qu’ils appelleront leur intérêt, et cette participation entraînera une complète communauté des peines et des plaisirs […]. Or, à quoi attribuer cet effet, sinon à notre constitution en général, mais plus particulièrement à la communauté des femmes et des enfants entre nos gardiens ? République V 464a.
Le recours à ce système communautaire et l’égalité des sexes qui en découle ne se comprend que si l’on prend en considération la tentative platonicienne d’éliminer totalement le danger d’une division de la cité par cette maladie de la Grèce qu’est la guerre civile ou stasis [42] . Une stasis qui peut, bien sûr, avoir lieu entre les citoyens eux-mêmes mais qui peut également se produire entre les sexes [43] . Il y a, dans la République, une volonté quasi-obsessionnelle d’éradiquer tout ce qui tendanciellement contient les germes d’une stasis. La cité pour être parfaite, doit être Une et indivisible. Le pari de Platon est de penser qu’il suffit d’homogénéiser et de stabiliser, voire de réifier la tête de la cité, pour que l’ensemble du corps social s’unisse et se rassemble sous l’autorité de ses dirigeants.
Peut-on alors dire comme Nicole Loraux que, dans la communauté des gardiens, ces mères « génitrices désappropriées de leur progéniture » sont « les mères humaines dans leur multiplicité ». Nous ne sommes certes pas dans le cas de figure du Ménexène où une seule mère engendre la totalité de l’humanité. Mais les mères multiples de la République sont si diluées dans un collectif unifiant, que finalement chacun des gardiens et des gardiennes peuvent prétendre avoir tous la même mère et que chaque femme peut prétendre être la mère putative de tous les individus de la génération qui la suit. Chaque femme est à la fois la mère symbolique de tous les gardiens mais la mère d’aucun en particulier. Ces femmes gardiennes sont-elles encore des mères ?
Si, comme le croit Loraux, les mères, dans leurs fonctions symboliques, sont dangereuses pour la cité, il n’est pas étonnant que Platon ai cherché à éradiquer de la cité idéale ce danger potentiel. Les femmes gardiennes ont accès aux plus hautes fonctions de la cité et gouvernent, avec les hommes, à condition qu’elles renoncent à leur rôle si particulier, si spécifique à leur être, de mère d’un enfant qu’elles ont mis au monde.
La question de l’Un et du Multiple, maintes fois posée dans l’œuvre philosophique de Platon, notamment dans le Parménide, le Théétète, le Sophiste ou encore le Philèbe, trouve dans la République une expression politique. Mais la cité idéale est une cité en pensée, « en parole », dont la réalisation importe peu [44] , « un modèle dans le ciel pour celui qui sait le contempler et régler sur lui son gouvernement particulier. » (IX 592 b). C’est une eidos de cité, Une, absolue et intelligible, immuable et éternelle, gouvernée par le souverain Bien. Cette cité dirigée par des philosophes, rejette le multiple dans les zones inférieures, celle de la classe des producteurs. Dans la République, Platon construit un modèle politique fondé sur la notion d’anthrôpos (homme et femme) et non sur celle de l’anêr. Le modèle peut ainsi s’auto-reproduire en interne, de façon homogène, sans qu’aucune division entre les sexes ne vienne s’y insérer.
Bibliographie
Annas, J. 1976. « Plato’s Republic and Feminism ». Philosophy 51 : 307-321.
Bernard, N. 2003. Femmes et société dans la Grèce classique. Paris.
Clavaud, R. 1980. Le Ménexène de Platon et la rhétorique de son temps. Paris.
Detienne, M. et Vernant, J.-P. 1979. La Cuisine du sacrifice en pays grec. Paris.
Georgoudi, S. 2002. « Gaia/Gé. Entre mythe, culte et idéologie ». In S. des Bouvrie (éd.), Myth and Symbol I. Symbolic phenomena in ancient Greek culture. Bergen : 113-134.
Joly, H. 1985. Le Renversement platonicien. Paris.
Labarde, J. 1991. « Anomalies dans le Ménexène de Platon ». L’Antiquité classique, Louvain-La-Neuve 60 : 89-101.
Leduc, Cl. 1994. « Citoyenneté et parenté dans la cité des Athéniens. De Solon à Périclès ». Dans les actes du colloque : La Grèce ancienne et l’anthropologie de l’Antiquité, organisé par Mètis (Athènes, 29 sept.-2 oct. 1992). Mètis IX-X : 51-68.
Loraux, N. 1981a. L’Invention d’Athènes. Histoire de l’oraison funèbre dans la « cité classique ». Paris, La Haye, New York (réed. 1993).
1981b. Les Enfants d’Athéna. Idées athéniennes sur la citoyenneté et la division des sexes. Paris (réed.1990, augmenté d’une post-face).
1987. « Le lien de la division ». Le Cahier du Collège international de philosophie 4 : 101-124.
1989. Les Expériences de Tirésias. Le féminin et l’homme grec. Paris.
1990. Les Mères en deuil. Paris.
1996. Né de la terre. Mythe et politique à Athènes. Paris.
1997. La Cité divisée. L’oubli dans la mémoire d’Athènes. Paris.
2001. « Aspasie, l’étrangère, l’intellectuelle ». Clio HFS 13 : 17-42.
Loraux, N. éd., 2003. La Grèce au féminin. Paris (traduction française de Grecia al femminile. Rome-Bari, 1993).
MacDowell, D. 1976. « Bastards as Athenian Citizens ». Classical Quarterly 26 : 88-91.
Okin, S. M. 1977. « Philosopher Queen and Private Wives: Plato on Women and the Family ». Philosophy and Public Affairs 6 : 342-375.
Sebillotte Cuchet, V. 2005. « La Terre-mère : une lecture par le genre et la rhétorique patriotique ». Kernos 18 : 203-218.
2006. Libérez la patrie. Patriotisme et politique en Grèce ancienne. Paris.
Sissa, G. 1990. « Epigamia. Se marier entre proches à Athènes ». In J. Andreau et H. Bruhns, (eds.), Parenté et stratégies familiales dans l’Antiquité romaine. Actes de la table ronde des 2-4 octobre 1986 (Paris, Maison des Sciences de l’Homme). Rome : 199-223
Vidal-Naquet, P. 1981. « Le Mythe platonicien du Politique. Les ambiguïtés de l’âge d’or et de l’histoire ». In Le Chasseur noir. Paris : 361-380.
Footnotes
[ back ] 1. Voir l’article « Et l’on déboutera les mères » dans Loraux 1989 : 219-231.
[ back ] 2. Loraux 1990 : 17.
[ back ] 3. Loraux (1990 : 99) : « Les mères grecques seraient effectivement dangereuses, et les femmes ne seraient jamais autant exclues de la cité que lorsqu’elles sont mères ».
[ back ] 4. Loraux 1990 : 41.
[ back ] 5. Loraux 1981a.
[ back ] 6. Loraux 1996 : « Figures anciennes, constructions modernes : la terre, la femme » (pp. 156-168), « Pourquoi les mères grecques imitent-elles à ce qu’on dit la terre ? » (pp. 128-143), « De Platon à Bachofen et au-delà » (pp. 145-155), « Le retour de l’exclu » (pp. 169-189).
[ back ] 7. Loraux 1996 : 129.
[ back ] 8. Loraux 1996 : 141.
[ back ] 9. Ménexène 236c : « Prends garde que mon maître (ê didaskalos) ne se fâche contre moi, si je divulgue son discours ».
[ back ] 10. Ménexène 236c.
[ back ] 11. Thucydide II, 35. Sur l’oraison funèbre de Périclès, cf. Loraux 1981a, op. cit.
[ back ] 12. Loraux 1996 : 130.
[ back ] 13. Clavaud 1980 : 178.
[ back ] 14. Ménexène 237c. Trad. Loraux 1996 : 130-131.
[ back ] 15. La fonction nourricière de la mère est mise en avant par Stella Georgoudi pour justifier l’absence de principe masculin dans le Ménexène : La terre apparaît surtout comme modèle nourricier que la femme a imité et continue d’imiter, dans la grossesse et l’enfantement. Tout se joue donc autour de la production de la trophè, ce qui expliquerait sans doute l’absence, dans ce passage de tout principe masculin. Georgoudi 2002 : 113-134.
[ back ] 16. Plus précisément : ce que le bœuf est aux animaux sauvage, le froment l’est à son tour par rapport aux plantes sauvages. De tous les fruits de la terre, il est le plus humanisé ; les plantes sauvage poussent toutes seules, là où le hasard des conditions leur est favorable. Le blé ne se récolte que cultivé au terme d’une année de soins attentifs comparable à l’éducation qu’on donne aux enfants pour en faire des hommes. Detienne et Vernant 1979 : 62.
[ back ] 17. Cf. Sebillotte Cuchet (2005 : 210) : « La terre comme mère apparaît ainsi très rarement seule dans le processus de génération et la notation du Ménexène selon laquelle la terre athénienne a enfanté (eteken) les ancêtres des Athéniens, seule cette fois puisqu’elle a à la fois porté et engendré (kuein et gennaein) doit, de ce point de vue, être soigneusement isolé. »
[ back ] 18. Sebillotte Cuchet 2005 : 217.
[ back ] 19. Cf. République VIII 558c. Sur cette question, voir Joly 1985 : 320-321.
[ back ] 20. Dans un article paru en 1991, J. Labarde relève différentes anomalies dans le discours de l’oraison funèbre dont l’usage répété du masculin quand le locuteur se désigne lui-même (autos, 246b6 ; dikaios, 246c2 ; tekmairomenos, c6 ; autos, 248e2), alors que ce discours est censé être celui d’une femme. Par ailleurs, Ménexène remet en cause l’identité de l’auteur de l’oraison à la fin du dialogue (hostis soi ho eipôn, « quel que soit celui qui t’a récité [cette oraison] », (249e1) alors que Socrate l’a explicitement attribuée à Aspasie dès le début (235e8-9) : Labarde 1991.
[ back ] 21. Notamment quand Aspasie prétend que les Athéniens ont remporté la bataille des Arginuses et “le reste de la guerre” (243d) alors qu’Athènes y a perdu sa souveraineté ; quand Platon fait allusion à des événements de 387, notamment le traité d’Antalcidas ou Paix du Roi (245b-e), que Socrate, mort en 399, n’a évidemment pu connaître. Pour plus de précision, cf. Labarde 1991, op. cit.
[ back ] 22. L’exclusion des femmes dans l’autocthonie n’est peut-être pas si radicale à l’époque classique. Voir dans ce volume l’article de Claude Calame : « Sacrifice des filles d’Érechtée et autochtonie. Fondations étiologiques dans l’Athènes classique ».
[ back ] 23. Loraux, N. 2001. « Aspasie, l’étrangère, l’intellectuelle ». CLIO, Histoire, Femmes et Sociétés 13 : 17-42. Article repris dans Loraux 2003.
[ back ] 24. « Seuls les hommes (andres) naissent de la terre dans la mythologie grecque ; la présence des femmes et des enfants supposent la vie civilisée et viennent ordinairement après », Vidal-Naquet 1981 : 372. Voir également, Loraux « Les bénéfices de l’autochtonie » dans Loraux 1996 : 36.
[ back ] 25. Cette affirmation selon laquelle la terre athénienne a produit les anthropoi est isolée dans le corpus des epitaphioi qui ne connaissent que les andres. Voir Loraux 1981.
[ back ] 26. Ménexène 237d, trad. Loraux 1996 : 130-131.
[ back ] 27. Il est vrai que pour Platon, la Terre-Mère a parfois des accointances avec l’espace civique. Dans la République (IX 575d), le philosophe utilise, pour désigner la patrie, un terme dont il nous dit qu’il aurait une origine crétoise, celui de mêtris. Selon Violaine Sebillotte (2006 : 268) : « Platon introduit la mère à côté du père et déplace l’accent de l’ancestralité et de la fraternité de l’oikos vers le féminin de la patris, c’est à dire en premier lieu la terre ».
[ back ] 28. Loraux 1996 : 188.
[ back ] 29. « C’est à des hommes que nous nous adressons et non à des dieux » (Lois V 732e).
[ back ] 30. (Lois VI 785b) : « Quant aux fonctions militaires qu’on croirait devoir imposer à des femmes après la naissance de leurs enfants, on fixera ce qui est possible et convenable pour chacune d’elle, sans dépasser cinquante ans ».
[ back ] 31. Bon nombre de discours, sujets à caution, sont présentés par Platon comme “des contes de bonnes femmes”. Voir Lysis 205d ; Gorgias 527a ; Théétète 176b.
[ back ] 32. Trad. Émile Chambry.
[ back ] 33. Pour ne pas briser l’harmonie de la cité, il est important que les mauvais éléments rendent le sort responsable de leur infortune et non les dirigeants (République V 459e).
[ back ] 34. Rappelons qu’à Athènes, l’âge légal pour le mariage d’une jeune fille est de 14 ans. Cf. Bernard 2003: 57.
[ back ] 35. Si l’on en croit du moins Mac Dowell 1976. Pour Leduc 1994, qui a réexaminé le décret de 451/0 au regard des définitions qu’Aristote donne du citoyen, il ne fait aucun doute que le nothos né d’un père athénien et d’une mère athénienne avait accès à la citoyenneté.
[ back ] 36. « Quand les femmes et les hommes auront passé l’âge de donner des enfants à la cité, nous laisserons, je pense aux hommes, la liberté de s’accoupler à qui ils voudront, hormis leur filles, leur mère (…) ; Nous donnerons la même liberté aux femmes » (République V 461c).
[ back ] 37. Dans un tel système, un homme stérile peut, dans l’ignorance, concevoir sans problème qu’il est le véritable père d’un des enfants de la communauté tandis qu’une femme stérile saura, bien évidemment, qu’elle n’a pas mis au monde d’enfant. On touche ici un des points d’irréductibilité de la différence biologique entre l’homme et la femme.
[ back ] 38. Cf. Aristote, Rhétorique II 1398b : « Au sujet des enfants, ce sont les femmes qui toujours déterminent la véritable paternité ».
[ back ] 39. Parmi les nombreux tenants de cette thèse, citons : Annas 1976, Okin 1977.
[ back ] 40. Rappelons qu’à Athènes l’inceste était toléré entre frère et sœur non utérin mais, en revanche, formellement interdit entre frère et sœur nés de même mère et de pères différents. La loi spartiate sur l’inceste adelphique est, semble-t-il, symétriquement l’inverse de celle d’Athènes ; on autorisait le mariage entre frère et sœur utérins si ces derniers étaient de pères différents Sur les lois régissant relations incestueuses entre frères et sœurs, voir Loraux 1981b : 130 .
[ back ] 41. Sissa 1990 : 204.
[ back ] 42. Sur la caractérisation de la stasis comme maladie cf. République V 470c : « Quand des Grecs se battent avec des Grecs […] la Grèce est malade et en discorde (nosein kai stasiazein). » Dans les Lois, (V 744 d), Platon précisera qu’il est plus juste d’employer à propos de cette maladie le terme de diastasis, dissension, plutôt que celui de stasis, faction. Sur la signification grecque du mot stasis, « dissension », mais aussi « stabilité », « fixité, » cf. Loraux 1987 : 108-112, ainsi que Loraux 1997 : 22-26.
[ back ] 43. Sur la question de la stasis entre les sexes, voir Loraux 1989, op. cit.
[ back ] 44. Cf. République IX 592b : « Il n’importe d’ailleurs en rien qu’elle existe ou qu’elle doive exister quelque part ».